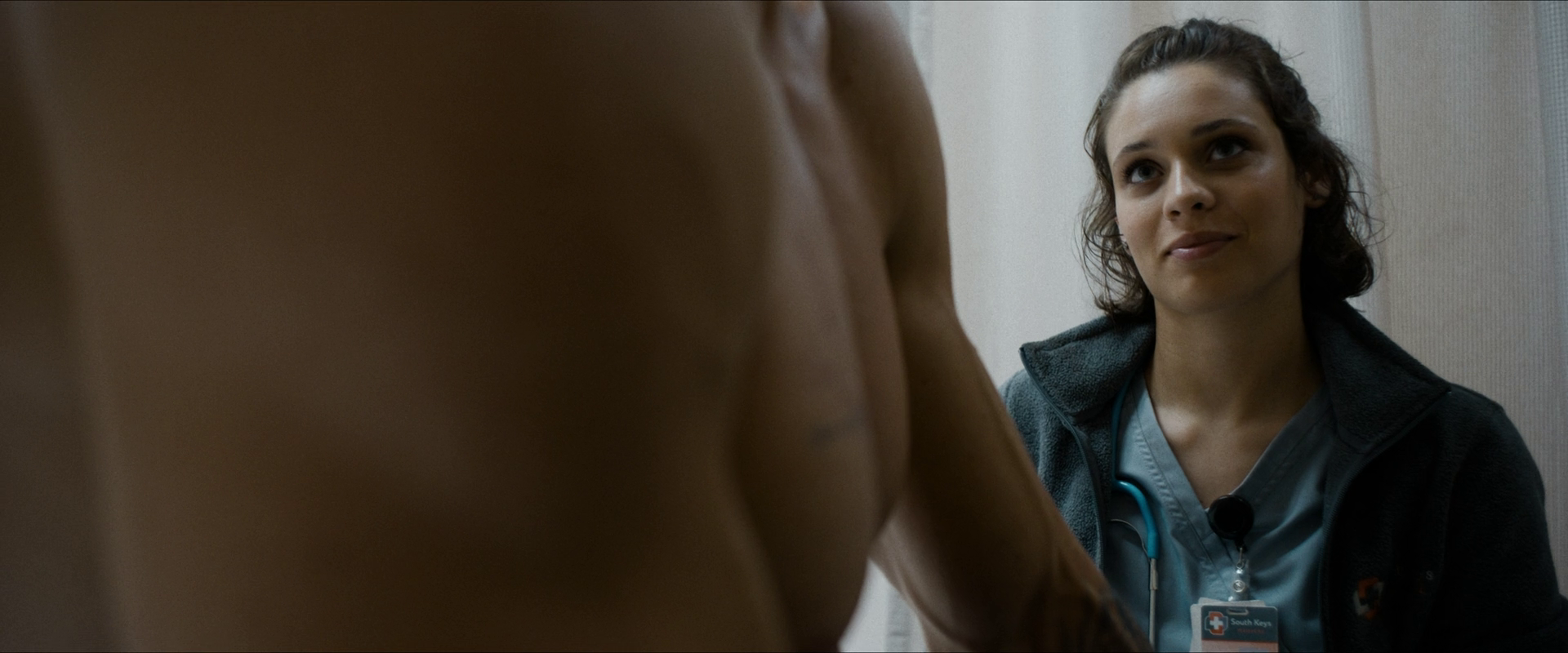Road House
 Il est des œuvres iconiques de la pop culture auxquelles on ne touche pas. Les films cultes dans lesquels a joué Patrick Swayze (1952-2009), par exemple : pas touche. Et si touche, paf le chien, comme en témoigne l’ignominieux remake de Point Break sorti dans l’indifférence générale en 2015. Et comme en témoigneraient à leur tour les remakes de Dirty Dancing et Ghost si jamais Hollywood la petite décidait de les tenter. Et l’on ne parle pas de chef-d’œuvre, hein, attention : on a dit « œuvres iconiques ». Road House, viril, cool et hargneux petit thriller réalisé par un compétent yes-man qui ne percera jamais vraiment et sorti en 1989, n’a RIEN du classique du cinéma… mais c’est une série B iconique, a fortiori pour les enfants des années 80, un peu à la façon du mauvais MAIS génial Commando avec Schwarzenegger. Swayze, alors au top de sa forme physique, y incarnait Dalton, un videur un peu philosophe qui n’hésite cependant pas à fracasser des crânes à coups de tatane si besoin est. L’intrigue était simple et efficace, l’antagoniste avait une classe folle (Ben Gazzara, l’acteur fétiche de Cassavetes), les molosses dudit antagoniste étaient patibulaires, la blonde était euh bien blonde (Kelly Lynch, « it girl » de l’époque), et Sam Elliot, déjà nanti de sa légendaire moustache, campait un sidekick du tonnerre dont le duo diablement divertissant qu’il forme avec Dalton a dû inspirer bien des concepteurs de jeux vidéos de « beat them all ». Enfant, l’auteur de ces lignes savait déjà qu’il n’avait pas affaire à du GRAND cinéma, mais les scènes de bagarre de Road House, réalisées avec une énergie et un souci de réalisme rares dans le cinéma US de l’époque, et probablement influencées par les compétences en arts martiaux de Swayze, étaient parmi celles qui l’impressionnaient le plus (aaaaah, ce duel à mort contre le personnage de Jimmy !). C’est pourquoi la nouvelle du remake de Road House n’aurait probablement inspiré qu’amertume et mépris aux popcorneurs du monde entier… si elle ne s’était pas accompagnée du nom de Jake Gyllenhall.
Il est des œuvres iconiques de la pop culture auxquelles on ne touche pas. Les films cultes dans lesquels a joué Patrick Swayze (1952-2009), par exemple : pas touche. Et si touche, paf le chien, comme en témoigne l’ignominieux remake de Point Break sorti dans l’indifférence générale en 2015. Et comme en témoigneraient à leur tour les remakes de Dirty Dancing et Ghost si jamais Hollywood la petite décidait de les tenter. Et l’on ne parle pas de chef-d’œuvre, hein, attention : on a dit « œuvres iconiques ». Road House, viril, cool et hargneux petit thriller réalisé par un compétent yes-man qui ne percera jamais vraiment et sorti en 1989, n’a RIEN du classique du cinéma… mais c’est une série B iconique, a fortiori pour les enfants des années 80, un peu à la façon du mauvais MAIS génial Commando avec Schwarzenegger. Swayze, alors au top de sa forme physique, y incarnait Dalton, un videur un peu philosophe qui n’hésite cependant pas à fracasser des crânes à coups de tatane si besoin est. L’intrigue était simple et efficace, l’antagoniste avait une classe folle (Ben Gazzara, l’acteur fétiche de Cassavetes), les molosses dudit antagoniste étaient patibulaires, la blonde était euh bien blonde (Kelly Lynch, « it girl » de l’époque), et Sam Elliot, déjà nanti de sa légendaire moustache, campait un sidekick du tonnerre dont le duo diablement divertissant qu’il forme avec Dalton a dû inspirer bien des concepteurs de jeux vidéos de « beat them all ». Enfant, l’auteur de ces lignes savait déjà qu’il n’avait pas affaire à du GRAND cinéma, mais les scènes de bagarre de Road House, réalisées avec une énergie et un souci de réalisme rares dans le cinéma US de l’époque, et probablement influencées par les compétences en arts martiaux de Swayze, étaient parmi celles qui l’impressionnaient le plus (aaaaah, ce duel à mort contre le personnage de Jimmy !). C’est pourquoi la nouvelle du remake de Road House n’aurait probablement inspiré qu’amertume et mépris aux popcorneurs du monde entier… si elle ne s’était pas accompagnée du nom de Jake Gyllenhall.

La présence de Doug Liman derrière la caméra a facilité les choses – normal, quand on a réalisé le premier film de la franchise Bourne et Edge of Tomorrow –, mais c’est vraiment le facteur Gyllenhall qui a fait la différence, l’acteur ayant la réputation de savoir choisir ses projets, comme en témoignent ses glorieuses années 2010 (End of Watch, Prisoners, Enemy, Nightcrawler, Demolition, Nocturnal Animals, Southpaw, Stronger…), remplies de performances oscarisables qui l’ont imposé comme un des acteurs les plus intenses que le cinéma US a en rayon. Il est arrivé au gars de s’égarer, dans les plus récents Velvet Buzzsaw et Ambulance, par exemple, mais ses performances ont rarement été le problème, et si ce remake de Road House proposait deux heures de l’homme, the man, philosophant l’air cool en donnant des coups de tatanes, ALORS il était possible que ce remake ne soit pas une énième mauvaise idée. Son talent pour incarner des personnages complexes, combinant bonhomie et animalité, autorisait même à espérer une réinvention du personnage de Dalton. Las ! Doug Liman a, dans les grandes lignes, foiré son coup. Ce qui n’a pas empêché de tirer un certain amusement de son film, hein. Un amusement simplement très, très inférieur à celui qu’on tire du film de 1989.



Le premier acte du film, sans hésitation le plus réussi (le SEUL réussi…?), est pourtant sacrément relax dans cet univers qu’il cuisine à sa sauce comme s’il n’y avait ni passé, ni lendemains. Il pose habilement le décor et divertit le spectateur en lui donnant ce qu’il attendait, c’est-à-dire sa star hollywoodienne roulant des mécaniques dans un rôle de gars à la fois amical et redoutable qui semble lui aller comme un gant, les sympathiques personnages secondaires, généralement employés du bar, apportent une touche de fraîcheur (une touche de fraîcheur un chouïa plus « diverse » que dans le premier Road House, vous imaginez bien), on trouve même à certains un petit potentiel (spoiler alert, Liman ne fera rien d’eux ou presque), et bien que Road House 2024 ait une esthétique de film numérique assez bateau, ses scènes de castagne, bien chorégraphiées et fortes d’une technique innovante utilisée par le coordinateur des cascades Garrett Warren pour rendre les impacts de coups plus réalistes grâce à l’utilisation de CGI (1), n’ont pas à rougir de la comparaison avec celles du Road House original, notamment la première, très amusante, qui confronte Dalton à la bande de voyous qui ennuie régulièrement le bar. Non, le problème, c’est… après le premier acte. Le problème, c’est un déploiement d’arguments posant la supériorité des années 1980 sur les années 2020. Le problème, c’est un mauvais film, doublé d’un remake de facto superflu, dans lequel tout le charme et le talent de Gyllenhall ne suffisent pas. Le problème, c’est… ah merde, on ne vous l’a pas dit ? C’est un film Amazon Prime.
Oui, une plateforme de streaming. Une des plus grosses, même. Elles ont beau s’être légèrement calmées, ces dernières années, dans le domaine de la production cinématographique en comparaison de l’intifada des années 2010, on n’est certainement pas près de leur dire « bye bye », tragiquement. Pour savoir comment le remake de Road House s’est transformé en sortie VOD, parce que c’est ce qu’est un film de plateforme, une vulgaire sortie VOD qui ne s’assume pas, Google est votre ami, mais autant dire que quand on a appris ça, et appris que Doug Liman n’en était lui-même pas méga-satisfait, l’intérêt suscité par la présence de Jake Gyllenhall s’est un peu refroidi. Le cinéphile expérimenté savait que quelque chose merderait forcément, quelque part. Avec Road House, ça a commencé dès le deuxième acte. Le scénario, écrit à quatre mains par un gars inconnu au bataillon ET Anthony Bagarozzi, à qui l’ont co-doit tout de même le génial The Nice Guys de Shane Black, s’effondre rapidement. Compte tenu de la durée du film, en accompagnement de l’intrigue centrale, on espérait se réjouir d’un TAS de confrontations méga-« over-the-top » entre notre protagoniste sympa-mais-létal et des clients boulets et surtout pas assez attentifs… mais après des débuts prometteurs, ces scènes de videur, qui étaient un peu le cœur du premier Road House, se raréfient inexplicablement, laissant la place à un empilement cacophonique de rebondissements et de scènes de gangster fleurant bon le pire de Guy Ritchie, où l’humour, initialement léger, s’alourdit à son tour. On se demande un peu pourquoi parce qu’on est curieux mais sans TROP chercher non plus parce qu’au fond on n’en a rien à foutre : à partir de ce deuxième acte, l’intrigue criminelle se complique inutilement, artificiellement. Et l’ajout d’un élément méta avec le personnage de la gamine de la librairie, censé apporter une touche de modernité (et joué par une métisse, en plus, le peuple élu !!!), n’apporte, euh, rien. Parmi les flagrants ratages compte également la romance avec la ravissante infirmière jouée par la ravissante Daniela Melchior (de The Suicide Squad). Sans être un aspect CRUCIAL du Road House original, la romance avec Kelly Lynch faisait un charmant accompagnement du festival de bastonnade testostéroné, son personnage apportant un contrepoint civilisé, et incarnant le repos du guerrier, repos bigrement sexy, faut-il ajouter, parce qu’on était dans les années 80, et que les vêtements étaient optionnels ; en 2024, vous n’aurez… ben, rien de tout ça, tout juste un bôgosse et une belgosse, habillés comme au mois de juin et dénués d’alchimie, simulant de brefs gazouillis pour la caméra dans deux-trois scènes qui n’étofferont pas vraiment leur relation, faute de laisser le moindre souvenir, avant que le bastonneur ne retourne aux affaires – vous savez, les fameuses affaires dont se cognera royalement le spectateur.



Mais il est une chose que le qualificatif de « flagrant ratage » ne saurait décrire à sa juste, abjecte valeur : la performance proprement désastreuse du champion de MMA Conor McGregor dans le rôle de l’antagoniste – mais pas de l’antagoniste en chef, hein, ce dernier étant incarné avec un flagrant manque d’éclat par le toujours insipide Billy Magnussen, qui fait regretter Ben Gazzara. Connu pour son tempérament explosif et son charisme sur le ring, McGregor et sa barbe de viking avaient peut-être, dans l’esprit du studio, un avenir similaire à celui glorieux de Dwayne Johnson. Pourquoi pas ? Dwayne Johnson a, effectivement, montré la voix, enfin, grosso modo. Le problème est que le ring n’est pas une scène de théâtre, ce que Dwayne Johnson A compris, et que les qualités précitées de McGregor… ne transparaissent absolument pas à l’écran. Au risque de paraître cruel, ce que le gars a fait, ou plutôt ce que Doug Liman lui a fait faire sur ce film, est une des PIRES choses qui soient arrivées au film d’action américain, son cabotinage incessant frisant le ridicule dès les premières minutes, avant d’allègrement dépasser sa limite, transformant chacune de ses scènes en grand moment de malaise méritant sa place dans une de ces compilations YouTube du pire, tirant vertigineusement vers le bas un film qui ne volait déjà pas très haut, scellant son destin tragique en débarquant pour la seconde moitié du film (2) (on en viendra à espérer, à un moment, que le gars soit nul au point d’en devenir divertissant, mais non !). Si l’on devait voir le verre à moitié plein, l’expérience Conor McGregor au cinéma constitue un rappel utile qu’être acteur n’est pas JUSTE avoir une grande gueule et être à l’aise devant la caméra.
À acteur ignorant ce que signifie jouer, réalisateur oubliant ce que signifie réaliser ? Les détracteurs du cinéma de plateformes de streaming soulignent souvent, à raison, l’uniformisation esthétique de leurs films, raison pour laquelle on parle d’« image Netflix », par exemple. J’ai couvert mes arrières, dans le paragraphe où j’ai loué l’efficacité du premier acte, en rappelant l’esthétique discutable de Road House 2024, mais à ce moment du film, on n’a encore RIEN VU : plus les minutes passent, plus l’action se spectacularise, plus elle a recours aux CGI, et plus c’est, comment dire, hideux – l’attaque nocturne par une jeep en pixels à mi-métrage laisse augurer du pire. On ne va pas y aller par quatre chemins : sur le plan visuel, Road House 2024 est un véritable cas d’école de ce qu’il ne faut pas faire. La photographie a de sérieux couacs, alternant scènes surexposées, scènes correctement éclairées, et scènes nocturnes difficilement lisibles, mais surtout, sans partir en sucette comme Oliver Stone sous coke à l’époque de Tueurs nés, le film a un vrai problème de cohérence des styles visuels : certaines scènes semblent emprunter un style réaliste et granuleux rappelant le cinéma des années 80 pour des raisons qu’on devine, tandis que d’autres optent pour une esthétique moderne et épurée, créant une dissonance visuelle qui fait écho au bordel sans nom du scénario, de la colorimétrie fluctuante (passant de teintes froides et désaturées à des couleurs vives et saturées sans réelle logique narrative), et de la mise en scène de Liman. Ses choix de cadrages ne manquent pas de déconcerter à plusieurs reprises, avec, par exemple, des plans trop serrés rendant l’action difficile à suivre, comme lors du climax boum-boum sur lequel on reviendra, ou des plans larges mal composés diluant l’intensité dramatique de certaines confrontations (3). Quant aux CGI évoqués plus haut, ils seront bel et bien utilisés à outrance vers la fin pour un tas de mauvaises raisons, souvent d’une qualité inférieure aux standards de notre époque, et souvent mal intégrés, ajoutant à la confusion visuelle générale. Ou la confusion générale, tout court, devrait-on plutôt dire.



Et si l’idée était de laisser au pauvre Gyllenhall la charge d’assurer LA constante au milieu de ce chaos, ce n’était PAS bien pensé, Dougy. Toute sa rigueur et tout son talent ne peuvent gommer ce qui est BIEN davantage que de simples couacs. Son interprétation de Dalton est convaincante, mais elle est, au contraire, constamment sapée par un scénario qui ne sait plus ou donner de la tête et une direction artistique bancale. Le réalisateur semble avoir perdu de vue ce qui faisait la force de l’original, se paumant dans un festival de bidouillages visuels foireux là où sa caméra aurait dû rester rivée à son protagoniste en n’utilisant les CGI qu’en appui. Au lieu de ça, on a la course de hors-bord complètement surréaliste de la fin, la supposée apothéose aquatique, CLIMAX du film, qui n’est, au contraire, qu’une consécration du naufrage de la mise en scène de Liman : mal filmée, mal montée, visuellement repoussante, donnant moins l’impression d’être dans l’eau que dans un jeu vidéo de 2007, elle fait toucher le fond (ça va, les eaux sont peu profondes…) à un troisième acte déjà grotesque. C’est SI mauvais que l’on peine à croire que le type derrière cette séquence est le réalisateur de The Bourne Identity et Edge of Tomorrow, un peu comme, deux mois plus tôt, on peinait à croire que le suprêmement con Argylle avait été mis en scène par le réalisateur d’X-Men : Days of Future Past. Comme quoi. Liman serait-il en phase de déclin créatif avancé, comme le suggérait le four Chaos Walking ?
Vous l’avez compris, penauds popcorneurs, ce Road House 2024 échoue donc à capter la magie de l’original, et atterrit plutôt sur ses dents, en catastrophe. Il faut croire qu’une humble série B des archaïques années 80 vaut toujours mille fois mieux, sur le plan cinématographique, qu’une énième insignifiante production de plateformes de streaming destinée à être matée sur son téléphone, peu importe que son budget soit supérieur. Après tout, les plateformes de streaming sont capables de faire faire de la merde à un David Fincher, pourquoi ne seraient-elles pas capable de faire perdre son temps au grand Gyllenhall, comme Netflix l’avait fait avec Velvet Buzzsaw ? Aux fans du Road House original, on recommandera plutôt de revisiter une énième fois l’objet de leur affection cinéphage, éventuellement en blu-ray, pour ceux qui en sont restés au DVD…? Dans tous les cas, la leçon doit être claire, aussi claire que la médiocrité de notre époque : il est des œuvres iconiques de la pop culture auxquelles on ne touche pas. Même avec un grand acteur au casting. Quoiqu’un long plan-séquence de l’acteur en question observant simplement le brouhaha alcoolisé du bar dans les bottes super-cools de Dalton aurait valu au film une moins mauvaise note (voir ci-dessous les plans de Gyllenhaal se contentant de rester assis). En l’état, on a ce grand acteur et une belle démo de filmage de scènes de combat, tous deux perdus dans un mauvais film.
Notes
(1) Warren a utilisé une technique qu’il avait initialement développée pour Avatar, appelée le « Garrett shot », qui consiste à filmer les scènes de combat plusieurs fois de manière à capturer plusieurs angles et perspectives (voir l’épisode de VFX Artists React to Bad & Great CGI qui aborde brièvement le sujet). C’est plutôt réussi, mais discutable idéologiquement, même en gardant en tête que le cinéma est manipulation.
(2) Lui faire montrer son cul en le baladant à poil dans la rue a quelque chose de suprêmement ringard en ce qu’on imagine bien Liman & Cie se dire « ouaiiiiiis, on est trop des oufs, ça va trop poser le personnage en gars qu’est trop un ouuuuf, ouaiiiiiiiiiiiiiiis ».
(3) Tout ce que la petite scène du hors-bord entre amoureux a eu comme effet, en ce qui me concerne, a été de me rappeler celle de Miami Vice (2006) et combien Mann sait filmer… à la caméra numérique.
Ci-dessous, quelques captures d’écran du film en 4k, pour le plaisir :