
Top Gun : Maverick
 La chair de poule ne trompe jamais. Vous pouvez résister. Vous pouvez culpabiliser. Vous pouvez minimiser. Toute résistance sera futile si vous l’avez : la chair de poule ne trompe jamais. Et si vous ne l’avez pas, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf. La présente critique n’a été rédigée sous l’emprise d’AUCUNE nostalgie. L’auteur de ces lignes n’a jamais été fan de Top Gun, même gamin, même à l’acmé de son chaos hormonal de jeune adolescent désireux de célébrer son taux de testostérone historiquement élevé. Il a juste toujours trouvé Top Gun trop superficiel. Adulte, il se rappelle affectueusement la mise en scène « clippeuse » de Tony Scott, l’ambiance estivale de la photographie, les jolis plans d’avions, l’énergie de l’ensemble, les amusantes joutes de vestiaires entre bôgosses filmés comme dans une pub Calvin Klein, le charisme de Tom (ci-dessous, l’acteur appréciant combien on le trouve beau) et les beaux yeux pleins de lèvres de Kelly McGillis sur fond de You’ve lost that loving feeling… mais c’est tout. Dès son second visionnage, vers l’âge de 15-16 ans, la succession ininterrompue de combats de coqs et de concours de bites l’avaient ennuyé, et l’intrigue inexistante ainsi que le vide intellectuel n’avaient pas aidé. À vrai dire, ça fait donc plus de vingt ans qu’il… ok, je passe à la première personne pour ne pas faire mon Jules César, que J’AI vu le film. Aussi entendre le fameux thème musical du film, ici réarrangé avec respect par l’inévitable Hans Zimmer, ne m’a-t-il pas submergé d’émotion. Aussi relever la plupart des clins d’œil et autoréférences, autant de bonus destinés à réjouir les fanboys and girl, ne m’a-t-il pas plus excité que ça.
La chair de poule ne trompe jamais. Vous pouvez résister. Vous pouvez culpabiliser. Vous pouvez minimiser. Toute résistance sera futile si vous l’avez : la chair de poule ne trompe jamais. Et si vous ne l’avez pas, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf. La présente critique n’a été rédigée sous l’emprise d’AUCUNE nostalgie. L’auteur de ces lignes n’a jamais été fan de Top Gun, même gamin, même à l’acmé de son chaos hormonal de jeune adolescent désireux de célébrer son taux de testostérone historiquement élevé. Il a juste toujours trouvé Top Gun trop superficiel. Adulte, il se rappelle affectueusement la mise en scène « clippeuse » de Tony Scott, l’ambiance estivale de la photographie, les jolis plans d’avions, l’énergie de l’ensemble, les amusantes joutes de vestiaires entre bôgosses filmés comme dans une pub Calvin Klein, le charisme de Tom (ci-dessous, l’acteur appréciant combien on le trouve beau) et les beaux yeux pleins de lèvres de Kelly McGillis sur fond de You’ve lost that loving feeling… mais c’est tout. Dès son second visionnage, vers l’âge de 15-16 ans, la succession ininterrompue de combats de coqs et de concours de bites l’avaient ennuyé, et l’intrigue inexistante ainsi que le vide intellectuel n’avaient pas aidé. À vrai dire, ça fait donc plus de vingt ans qu’il… ok, je passe à la première personne pour ne pas faire mon Jules César, que J’AI vu le film. Aussi entendre le fameux thème musical du film, ici réarrangé avec respect par l’inévitable Hans Zimmer, ne m’a-t-il pas submergé d’émotion. Aussi relever la plupart des clins d’œil et autoréférences, autant de bonus destinés à réjouir les fanboys and girl, ne m’a-t-il pas plus excité que ça.


C’est sans doute pourquoi la nature de suite de Top Gun : Maverick, pourtant évidente, ne m’est pas instantanément venue à l’esprit lors de mon premier visionnage en salle. Faut le faire, je sais. Mais c’est une BONNE chose. Pas besoin de ça. Son générique d’introduction aurait pu être précédé d’un panneau indiquant ce qu’il y a à savoir du protagoniste et du contexte, et basta. C’est aussi pourquoi je n’ai pas instantanément considéré ce film comme une des meilleures suites de l’histoire du cinéma. Alors que j’aurais dû. Parce que ça l’est. Et si les références au premier film ne m’ont pas emballé plus que ça, c’est AUSSI parce que j’étais trop occupé à être emballé par le second.
Trente-six ans. Une suite, trente-six ans après. Cela s’est-il seulement déjà vu ? Question rhétorique. Combien de suites bien moins à la traine se sont royalement vautrées ? Autre question rhétorique. Hollywood n’est même plus foutu de reproduire ce qu’il faisait de bien il y a DIX ans… alors TRENTE-SIX ? Plus les studios tombent dans la décrépitude créative, plus ils recourent à la nostalgie, piège affectif, pour un résultat généralement catastrophique, de Jurassic World au dernier Spider-Man (sic) en passant par Terminator et le dernier SOS Fantômes (re-sic). Parce que les films n’ont généralement, simplement, rien à voir avec les classiques dont ils prétendent prendre la suite. S’ils sont repris par les géniteurs des films originaux, alors ces derniers ont perdu le feu sacré entre temps. S’ils sont repris par une aspirante-relève, alors cette dernière n’a rien compris à ce qui faisait la réussite des films originaux, peu importe sa bonne volonté. Et les exceptions ne feront que confirmer la règle. Trente-six ans, vraiment ? Dans un paysage cinématographique aussi mal en point que le nôtre, c’était voué à se planter. Non ? Non.
[Warning : le présent article est rempli de digressions, sur le génie de Saint Thomas de Cruise, sur sa carrière, sur l’opposition quasi-philosophique entre effets spéciaux mécaniques et effets spéciaux numériques, sur l’avenir du cinéma d’action, sur feu-Tony Scott, sur la vie, sur la mort. Bien que l’utilisation des CGI dans le film présentement critiqué soit abordé dans les chapitres 3 et 4, la critique du film ne commence vraiment qu’au chapitre 6. En tout cas, les deux premiers chapitres, c’est juste Tom Cruise. Mais ils sont bien aussi, hein !]
Sommaire
Americana
Top Gun : Maverick pourrait bien être le film le plus américain de toute l’histoire des films américains – peut-être Top Gun l’était-il jusqu’ici. Relaxons-nous : à moins d’être de ceux qui assimilent l’Oncle Sam à Satan, généralement par anticapitalisme et mépris des cheeseburgers, on peut prendre cette affirmation positivement.

D’abord parce que cette qualité prête à l’ethos ET au cinéma étasuniens une sorte d’absolu, dont le respect zélé garantit au spectacle une efficacité et une radicalité réjouissantes. On pourra détester le spectacle par incompatibilité morale, par exemple – l’Oncle Sam et son hypocrite « guerre juste » ont des comptes historiques à rendre –, mais on ne pourra PAS l’accuser d’à peu près, ni d’inconsistance, ni de paresse, ni de couardise. Le spectacle est américain jusqu’à la plus enthousiasmante hyperbole. De toute évidence, ce cru 2022 ne pouvait qu’avoir des airs de publicité géante de recrutement de l’US Navy, comme l’a été Top Gun en son temps. C’est indéniable. Et là encore, les fragiles professionnels côté gauche antimilitariste chouineront. Aux USA, sans aller jusqu’à faire tourner de l’œil la gauche woke comme l’a fait le « virilisme » de The Northman, Top Gun : Maverick a fait l’objet de débats houleux (1). Mais ça, c’est l’affaire des idéologues. D’un point de vue non contaminé par la politique, cet aspect du film lui donne, au contraire, de prodigieux airs d’Étoffe des héros 2.0. L’héroïsme est universel. Qu’il soit le fait d’un Américain ou d’un Nord-coréen collectionneur de timbres ne fait aucune différence (au fait, ça existe, les timbres, en Corée du nord ?).
Ensuite parce que l’Amérique de Top Gun – désolé mais quel titre –, toute parfaitement américaine soit-elle, est l’interprétation qu’en fait le plus américain de ses acteurs, Tom Cruise, et que les trois seules critiques dont ce dernier ait jamais souffert, sur sa petite taille, son rapport discutable à la scientologie, et son craquage de plombs chez Oprah, n’ont rien à voir avec son talent d’acteur. Ou de producteur. Ou de cascadeur. L’Amérique, c’est la glorification de l’accomplissement individuel et la positive attitude comme mode par défaut… et Tom en est l’incarnation de chair, au point de malmener la sienne. Dans Top Gun, il jouait une jeune tête brûlée. Dans Top Gun : Maverick, bien que son personnage ait perdu sa morgue de jeunesse, il joue… euh… une tête brûlée, plus âgée. « The Sky is the limit », comme on dit en berrichon.

Top Cruise
Loin de moi l’idée de tailler le cinéma de feu-Tony Scott, mais je me dois de poser deux questions d’importance cruciale : qui aurait cru a) que son film, de plus en plus vieux et par conséquent de plus en plus à la traîne, aurait POUR DE BON cette suite bieeeen trop longtemps évoquée pour être vraie, et b) que cette suite serait un des plus prodigieux blockbusters hollywoodiens de mémoire récente ? Réponse : personne. Enfin, si, il y en a forcément qui l’ont vu venir, mais des petits malins, il y en a toujours, ce sont eux aussi les exceptions confirmant la règle (chut). J’aurais cependant dû le voir venir, et ce pour une raison : le fait qu’un de ces petits malins s’appelât Tom Cruise.

Tom Cruise, l’homme décrit par ses collaborateurs comme l’aventurier terminal, en présence duquel il est fortement déconseillé de prononcer le mot « can’t ». Le moment de Top Gun : Maverick où son personnage dit « I can’t, this is over » est un des rares défauts du film. Le principe est simple : quand Tom Cruise dit que quelque chose va se faire, il est écrit que cette chose se fera, quelle que soit ladite chose, sous l’effet astrochimique de sa SEULE volonté… non pas de puissance, pour citer le film de Riefenstahl sur le nazisme, mais de divertissement. Le Triomphe de la volonté de divertir, si vous voulez. Si la chose a mis tant de temps à se lancer, ce n’est probablement pas tant une question de temps, car Tom Cruise contrôle le temps, ce qui explique qu’il ne vieillit pas, mais parce qu’il attendait simplement de recevoir LA bonne proposition. Il y a quelques années, il la reçut, des mains de Christopher McQuarrie, McQ, son fidèle associé depuis Mission impossible – Rogue Nation, et, tel Dieu au huitième jour, il vit que cela était bon.
Ainsi Top Gun Maverick DEVAIT-il donc arriver car Tom Cruise voulait qu’il en soit ainsi et qu’ainsi en fût-il (hum), mais aussi par la contagiosité de son énergie suprahumaine. À partir du moment où le projet s’est mis en branle, tout semble avoir glissé sur les rails de cette énergie, et sans le COVID, l’affaire aurait été impérialement pliée pour l’été 2020 – rien ne dit pour autant que le film aurait été aussi réussi car ces deux ans ont laissé au réalisateur Joseph Kosinski le temps de peaufiner le bazar, mais c’est un autre sujet (2). L’entertainer a donc ses limites, il ne peut vaincre une pandémie par la seule force de sa volonté, mais quiconque d’autre aux manettes aurait eu de grandes choses de laisser tomber. Pas lui, ni ses gens. J’ai parlé d’énergie contagieuse : à sa manière, Tom Cruise EST, lui aussi, un virus, un virus qui tue le défaitisme. Il suffit d’écouter de nouveau ses collaborateurs : un simple contact, et son enthousiasme fait un nouveau contaminé. Le gars pourrait déclarer à son équipe qu’au lieu de tourner un film, ils vont envahir Cuba, passé un court instant de flottement, elle finirait par foncer – « Hé mais… mais… ouais…! OUAIS !! C’est TROP faisable !!! ». Pas étonnant qu’il ait autant brillé en motivational speaker « viriliste » (sic) dans Magnolia. Si Tom Cruise était président des USA, le parti communiste chinois s’alignerait instantanément sur les politiques économique et étrangère de Washington et ferait du jour de son investiture une fête nationale.
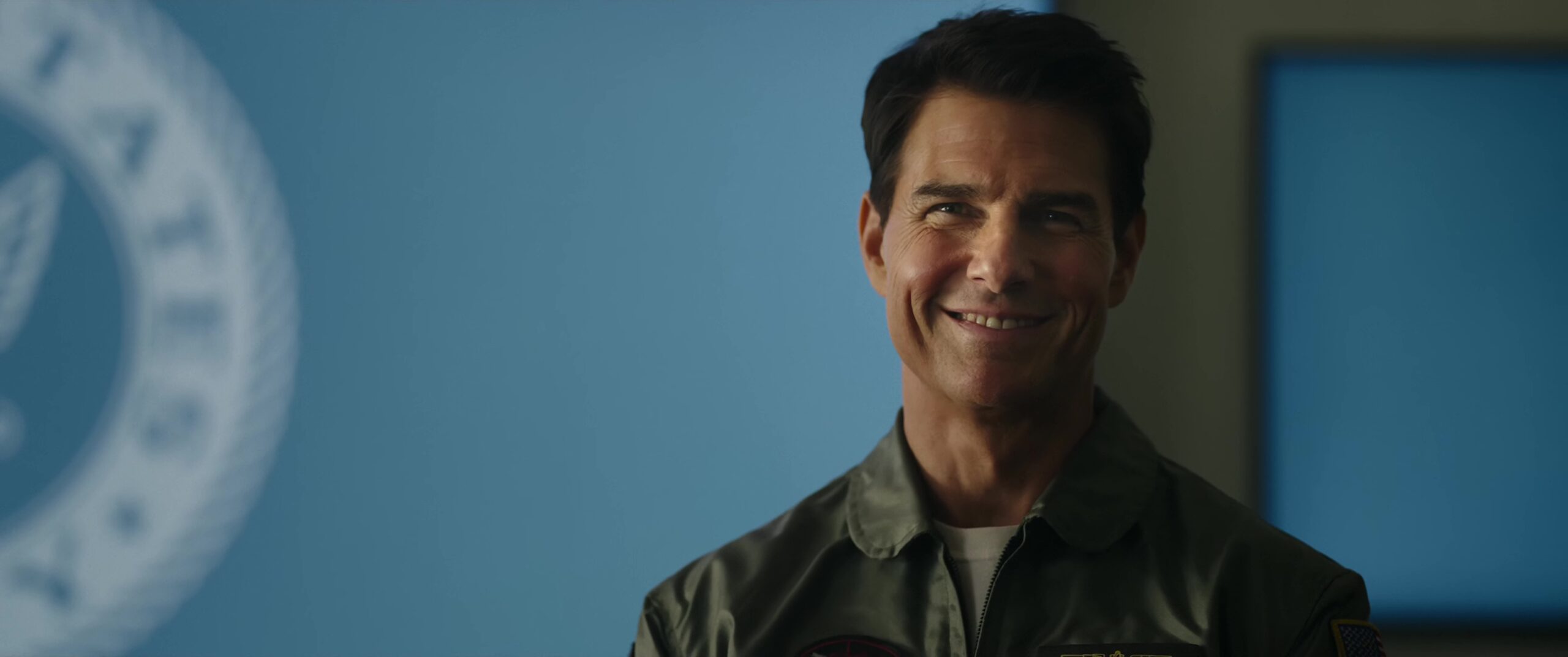
Au début du film, le fidèle Hondo dit à Maverick, alors que ce dernier s’apprête à faire une connerie : « I don’t like that look ». Ce à quoi Maverick répond : « it’s the only one I’ve got ». Le regard de Tom Cruise. Soyons francs, le présent film aurait tout aussi bien pu s’appeler Top Gun : Tom Cruise. On entend d’ailleurs sur YouTube des langues fourcher et dire « Top Cruise » à la place de « Tom Cruise ». Tom Gun ?
Plus d’illusion que prévu
« La psyché de l’acteur SAIT quand un décor est faux, le spectateur SENT quand un décor est faux, et la caméra PROUVE que ce décor est faux en filmant dans des angles qui ne sont pas réels. » (John Seale, chef opérateur de Hitcher)
En tant que défenseur des effets spéciaux pratiques, à l’ancienne, je ne peux qu’applaudir des deux mains tout film qui, à l’ère Marvel, a fait l’effort d’y recourir. C’est pourquoi j’aurais tant aimé que Top Gun : Maverick (j’aimerais me contenter d’écrire Maverick mais penserais trop à l’excellente comédie éponyme avec Mel Gibson) soit le film qui s’est tourné vers Hollywood et lui ait dit : « hey, Hollywood, tu vois, tes CGI, tu peux te les carrer où je pense ». De toute évidence, le film ne pouvait qu’y avoir recours en certains endroits, par exemple, quand nos aviateurs envoient leurs F-18 entre les deux poutres d’un pont, parce que les cascades étaient trop dangereuses à effectuer et que l’US Navy ne pouvait laisser Tom et ses petits copains prendre TROP de risques avec leurs joujoux à cent millions de dollars. Faut pas être con. Mais j’aurais aimé qu’il y ait recouru le MOINS possible. Dans les cas de force majeure only. Or, contrairement à ce qui se dit couramment, cela n’a PAS été le cas. Les trois avions filant l’un derrière l’autre le long d’une rivière, voir l’image ci-dessous ? Deux ont été ajoutés numériquement. L’impressionnant plan de la « formation diamond », voir l’autre image ci-dessous ? Seul l’avion de Tom Cruise est réel – et Tom Cruise dedans, évidemment. Le film compte bien plus d’avions de chasse en CGI, numériquement ajoutés, que la promo du film n’a laissé entendre, des avions fictifs qui ont berné jusqu’à des youtubeurs pilotes de chasse qui ont analysé le réalisme du film (être un spécialiste de l’aviation n’est pas être un spécialiste des effets spéciaux). À ceux qui aiment se faire du mal, je recommanderai ce grand moment de désillusion où l’on apprend l’étendue du recours aux CGI. Les motifs : a) des choses qui ne pouvaient être filmées en vrai, b) des cascades trop risquées pour être effectuées légalement, comme je le suggérais plus haut, c) la mise en valeur de certains panoramas, comme l’ajout de montagnes, et d) l’ajout d’avions de chasse dans pas mal de plans d’avion(s) de chasse. En d’autres termes, plus de pixels que prévu. Montrant quand même combien les petits gars du département de l’illusion numérique ont fait un travail d’orfèvre, voyons les choses de façon positive.


La position sage, dans le fameux débat qui oppose effets spéciaux mécaniques et effets spéciaux numériques, est sans doute de les accepter l’un comme l’autre TANT que l’illusion est là. Après tout, le cinéma n’est-il pas qu’illusion ? On ne demande qu’à croire à ce qu’on voit, MÊME quand on sait que rien de tout ce qu’on voit n’est vrai – c’est entre autres pourquoi les effets spéciaux ratés énervent autant. On ne demande qu’à CROIRE au porte-avion volant de Samuel L. Jackson dans Avengers, on ne demande qu’à CROIRE que c’est à l’intérieur de ce porte-avion imaginaire qu’interagissent nos superhéros aux pouvoirs imaginaires. Et l’on SAIT qu’un film ne doit pas être jugé à partir de sa gestation, ni en fonction des conditions de sa production, mais sur la seule base du résultat, de ce qu’on voit à l’écran, de l’efficacité de l’illusion.
Mais on peut établir une limite de sa tolérance aux CGI. Par exemple, là où commence la paresse, celle d’un réalisateur qui va recourir à un fond vert pour ne pas s’emmerder à déplacer son équipe jusque devant une station-service ou un champ de blé, ou à trouver une vraie cafetière. C’est surtout là que se situe le problème des CGI, à l’heure actuelle : leur capacité à, désormais, TOUT remplacer, ou presque. Dans telle scène, tel personnage doit marcher dans une rue de New York : boum, on va le faire marcher dans le studio, devant un fond vert, et on ajoutera la rue de New York en postproduction – cf. Spider-Man : No Way Home. Et le public n’y verra que du feu. Ce n’est donc pas à 100% une question de qualité, ni d’effectivité, mais de RAPPORT au cinéma, du lien de confiance qu’on établit avec le médium. Si les choses sont claires, si le studio arrive avec un film où l’usage des CGI est entièrement justifié, comme le somptueux Tron : L’Héritage, pour citer un film de Kosinski, AUCUN problème ne se pose. D’autres cas de figure sont plus problématiques (3). Je me rappelle ma réaction à ce reportage sur la conception de Forrest Gump, qui expliquait avec émerveillement que les hélicoptères volant dans le ciel en arrière-plan avaient été ajoutés digitalement : j’avais partagé cet émerveillement. Mais ce n’était pas tant le cinéma qui était célébré que l’accomplissement technique. Rien n’égalera jamais le ballet d’hélicoptères loués par Coppola au dictateur Ferdinand Marcos dans Apocalypse Now (ci-dessous).

Mais bien moins que d’habitude
CEPENDANT. Dans Top Gun : Maverick, le ratio de chiqué est historiquement bas, parce que dans le monde de Tom Cruise, une partie conséquente de ce qui peut être fait sans recours aux CGI ni autorisation de l’US Navy mérite le recours minimal au chiqué, en opposition à un zeitgeist qui l’emmerde très clairement. Le positionnement de la star vis-à-vis des CGI n’est pas qu’ils sont mauvais en soi, ça ne cadrerait pas avec sa filmographie, mais simplement qu’ils doivent être utilisés avec parcimonie car leur abus peut enlever quelque chose à un film, notamment en influençant en mal les performances des acteurs.
Et puis, quand j’écris que le cinéma n’est qu’illusion… « peut-être pas tant que ça », semblent répondre certains. Christopher Nolan a exprimé ce sentiment à bien des reprises, avec la bataille aérienne de Dunkerque, l’embardée à moto de The Dark Knight, ou encore le tour de manège Inception. Tom l’a également exprimé. Parce que son public, à Tom, bah, il mérite mieux. Si son cinéma relève de l’illusion, alors ce sera de l’illusion qui a sollicité ce que la réalité a de moins illusoire. Et donc, dans son cas, de plus risqué. Pour le plus grand plaisir de son public… qui SAIT que ce grand malade a accompli telle cascade et telle cascade pour de vrai. De son public qui vient en partie pour cette raison. L’appréciation du public est généralement indépendante des conditions de la conception du film parce qu’il n’en sait généralement rien… mais quand ça devient une marque de fabrique, quand voir Tom courir, sauter, s’accrocher à des trucs, piloter des machins, se casser la cheville sur un rebord d’immeuble et continuer de cavaler, voire manquer de se noyer devient une plus-value… « qu’est-ce qu’on fait, chef » ? Eh bien, on fait avec. Parce que le cinéma n’est pas QUE de l’illusion. C’est aussi de la performance. Alors que la star hollywoodienne moyenne requiert une doublure pour descendre deux marches d’escalier au cas où elle glisserait et se foulerait un orteil, Tom n’en exige aucune pour grimper le Burj Khalifa, et que voulez-vous, ça se voit, voilà. C’est un fait indéniable que ça se voit, comme le public français pouvait le ressentir devant les cascades hallucinantes de Bébel dans L’Homme de Rio ou le public hongkongais devant celles, suicidaires, de Jackie Chan dans Police Story, et on ne peut QUE les aimer pour ça.
Ainsi, les spectateurs dont l’appréciation de Top Gun : Maverick reposait en bonne partie sur leur croyance que quasiment tout a été filmé « pour de vrai » (sic) pourront s’estimer déçus… mais si les CGI sont davantage présents dans le film qu’espéré, sur les plans logistique et pratique, et donc en matière d’esprit, Top Gun : Maverick reste l’anti-royaume du chiqué, l’anti-fond vert, l’anti-Menace Fantôme. Peut-être aura-t-on mieux à l’avenir, mais pour l’instant, chouiner relèverait de l’ingratitude la plus scandaleuse. Parce que le show que propose Tom est unique, et qu’il mérite mieux que ça.


Post-Tom
Tom, l’ultime showman. Peut-être le VRAI « last showman », désolé, Hugh Jackman. Celui avec qui mourra peut-être ce type de show, disparaissant englouti dans les eaux tiédasses du chiqué conformé. Si tel n’est pas le cas, tant mieux. Si tel est malheureusement le cas, la fin aura eu une sacrée gueule.
Mais il n’est même pas nécessaire de parler de la MORT de Tom – car Tom mourra un jour, si, si. Le sujet de sa retraite suffit. L’homme aura soixante ans quand sortira, l’an prochain, la première partie de Mission impossible : Dead Reckoning Part One, dont le long teaser met déjà l’eau à la bouche. Roger Moore en avait cinquante-sept dans son dernier James Bond, et il ne faisait pas le millième de ce que Cruise fait en matière de performance physique. C’est surtout dans le cadre de cette franchise que la question se pose : qui prendra la relève ? Mieux : qui POURRA ? On voit d’ici venir le méga-casse-tête, car l’hypothétique successeur devra réunir PLUSIEURS qualités, et non seulement celle d’acteur-cascadeur (partons donc du principe que TOUT LE MONDE sait que Cruise fait tout lui-même.) D’abord, il faudra qu’il soit une star hollywoodienne un minimum établie : une partie du plaisir que l’on tire de ses cascades de taré tient au fait qu’on « connait » l’auteur desdites cascades. Un acteur sorti de nulle part aura beau exécuter à la perfection les exactes mêmes cascades, elles ne produiront pas le même effet sur le spectateur, de la même manière que voir Scarlett Johansson et Gal Gadot dans une scène d’ébats torrides ne produira pas le même effet qu’une scène de vulgaire porno lesbien (le parallèle m’est venu comme ça, on passe à la suite). Oui, le public « connait » Tom Cruise, depuis quarante ans. Ce seul prérequis promet de rendre diablement ardue l’aventure de sa succession. Ensuite, ce successeur devra avoir le package de tout acteur populaire, le charisme et le talent. Pour finir, il devra réunir le même prodigieux esprit d’initiative combiné à la même liberté d’action… autant dire la thune et l’assise suffisantes pour ne pas effrayer tous les assureurs de la planète. On a parlé de Jeremy Renner pour prendre la suite, à un moment. J’aime beaucoup Jeremy Renner, mais voilà, quoi. Alors ? Quelqu’un ?
Mais ne flippons pas outre mesure : si la franchise Mission impossible (voir l’image ci-dessous) continue sans lui, l’homme restera sans aucun doute aux manettes en tant que producteur de sa franchise chérie et supervisera sans aucun doute un peu tout. Peut-être qu’Ethan Hunt restera carrément dans les films, en tant que mentor, par exemple, coup classique (4). Trouver la tête d’affiche d’un Mission impossible : L’Héritage (5) n’en sera pas moins un challenge.

Revenons à des considérations plus positives. Les effets spéciaux de Top Gun : Maverick sont donc d’abord Tom, le mec qui court vite – c’est tellement une marque de fabrique qu’on le voit ENCORE courir dans le teaser de Dead Reckoning Part One –, puis le résultat de son irraisonnable exigence, qui est la poursuite de l’excellence dans tous les domaines. Non, le showman n’a pas joué QUE dans des bons films, mais on parle d’un acteur dont seulement 23% de la filmo est à jeter, selon les études de mon institut de recherche, soit dix sur quarante-trois (6). Tom Cruise sait choisir ses films, a fortiori quand ce sont des projets qui lui sont chers, nier son apport à l’entertainment hollywoodien relèverait de la pire mauvaise foi. L’acteur a touché à une grande variété de genre – j’aurais juste aimé le voir dans au moins UN slasher – et une grande variété de rôles – j’aurait juste aimé le voir jouer plus d’UN véritable méchant (Vincent dans Collateral) (7). Et si ses performances se ressemblent dans plusieurs de ces excellents films, Tom s’étant très clairement habitué à jouer Tom, au moins, il le fait très bien.
Transcender les archétypes
Mais pour qu’un film avec Tom Cruise soit réussi, une compilation de ses cascades ne suffit pas (enfin, probablement) : il faut une intrigue, et une décente, il faut une narration tout pareil, il faut une substance à la hauteur du show, que ce dernier ne soit pas un bel objet creux. S’il est possible d’arguer qu’un film aussi spectaculaire que Top Gun : Maverick peut se dispenser d’une écriture de grande qualité, on peut aussi arguer l’inverse, que quelque chose d’aussi sensationnel dans la forme mérite un fond un tant soi peu au niveau. Alors ? Au rayon positif, ce qu’on est obligé de reconnaître au scénario du film est qu’il se distingue par la conception et la lisibilité de la mission vers laquelle tend son action : autant on se contrefoutait de celle de Top Gun, autant celle-ci intéresse carrément jusque dans ses aspects logistiques et stratégiques, on attend son exécution avec impatience, et quand arrive ladite exécution, on ne se contente pas du boum-boum. On peut aussi saluer la caractérisation du protagoniste : bien qu’il reste dans les clous de la figure archétypale cruisienne, son évolution par rapport au premier Top Gun est sensible. Pour le reste… il vaut mieux ne pas TROP attendre du film. Rien dans le scénario de Top Gun : Maverick ne réinventera la roue.


À l’exception de Rooster, le fils de feu-Goose, les personnages des jeunes pilotes sont des vignettes parfois à peine caractérisées, à commencer par l’arrogant Hangman, que son interprète Glen Powell a joué sur un seul mode mono-expressif, son visage constamment flanqué d’un sourire suffisant. On aura la tête de nœud du groupe finissant par se racheter par un acte de bravoure qui le réconciliera avec le héros – figure que j’ai de nouveau observée, récemment, en visionnant Tu ne tueras point –, le supérieur constamment en pétard et pas exactement fan des méthodes du héros (ici joué par le toujours excellent Don Draper, finalement de retour dans l’armée) finissant par apprendre à les apprécier et à le respecter, les vieilles rancœurs finissant par s’évanouir sous les feux ennemis, ou encore des gros clichés du répertoire comme l’enterrement patriotique d’un personnage sur fond de salve de tirs, ou ce moment où le héros jette le manuel à la poubelle, façon « oubliez tout ce que vous avez appris ». Oui, on aura ça, et plus encore, et même ce qu’on n’aura pas, on l’aura quand même, tant Top Gun : Maverick a quelque chose d’une anthologie des plus beaux clichés du registre. La même chose peut être dite de Penny, le « love interest » du film joué par Jennifer Connelly, toujours splendide nonobstant la tragique perte des formes qui l’ont rendue populaire au début des années 90, en plus de l’intense bleu de ses yeux : rien de neuf sous le soleil. On voit le potentiel, avec sa fille pas née de la dernière pluie, mais elle, on ne la verra pas assez.
Certains auront sans doute envie de dire « sans déconner ? » car la simplicité du scénario est presque un prérequis dans ce genre de film. Le spectateur n’est pas censé s’attendre à du Tolstoï, il est seulement en droit d’attendre quelque chose de pas con. Mais aussi triste que cela soit à dire, quelque chose de « pas con », dans le blockbuster hollywoodien actuel, c’est déjà énorme. Voyez combien de blockbusters cons sont sortis en l’espace des douze derniers mois, du neuvième Fast & Furious au troisième Jurassic World en passant par le quatrième Matrix, le vingt-cinquième James Bond, le troisième Spider-Man avec Holland (quelques uns de ces films ont été mentionnés plus haut) et les « grosses » sorties des plateformes. Des films qui insultent l’intelligence du spectateur, même ceux qui se croient intelligents, comme Matrix Resurrections. Un film qui ne vous prend pas pour un con et ne prétend pas retourner les cerveaux, c’est déjà pas mal, non ? L’humilité a quelque chose de plaisant. Et ce n’est même pas une façon de qualifier le film de roi borgne au milieu des aveugles. Quand Top Cruise dit avoir attendu le bon pitch pour lancer cette suite, ce n’est pas du foutage de gueule. À défaut d’être original, Tom Gun : Maverick, c’est du divertissement intelligent et carré qui ne cafouillera quasiment jamais. J’ai parlé de connerie : cette fois-ci, l’US Navy ne passe pas l’éponge sur TOUT ce que fait le protagoniste, contrairement à celle de 1986… comme si McQ et Cruise SAVAIENT qu’ils ne pouvaient pas se permettre de torcher le travail. Quoique dans la vraie vie, le mec se serait tapé la cour martiale depuis belle lurette.


Une personnalité énergique
« Pas assez », ai-je écrit un peu plus haut. Je suis de l’avis de ceux qui se satisfont, compte tenu de l’absence de matière grasse dans le film, que les scénaristes aient préféré se concentrer sur les pérégrinations de notre héros plutôt que d’aller passer du temps auprès de ses élèves. Après tout, le titre du film ne finit-il pas par MAVERICK ? Peut-être le fait qu’on ne voit absolument pas passer les cent-trente minutes du film tient-il à cette simplicité d’approche, McQ et Kosinski ayant suffisamment fait confiance à la force élémentaire de leur intrigue pour ne pas ressentir le besoin de la charger davantage. Bien sûr, si troisième Top Gun il y a, et qu’il reprend les personnages des jeunes pilotes pour leur réserver un développement pareillement squelettique, LÀ, on pourra se plaindre. Ceci étant dit, lorsqu’on voit leurs interprètes interagir ensemble dans des interviews groupées, et qu’on réalise le potentiel de chacun, potentiel qui, dans certains cas, ne nous est quasiment pas apparu alors qu’on regardait le film, il n’est pas insensé de regretter que ce dernier n’ait pas duré 2h30 – souhaiter qu’un Top Gun dure 2h30, qui l’aurait cru (8) ? Dans certains cas plus que d’autres, je pense à la prometteuse Monica Barbaro, la fille de l’équipe. Il faut dire que Top Gun : Maverick, contrairement à Top Gun, ce n’est pas JUSTE des bôgosses grandes gueules paradant dans la moiteur californienne.
Fort heureusement, en vouloir PLUS n’est pas le pire des signes, pour un film. Si l’on devine tout le potentiel de ces personnages, c’est parce qu’on les a suffisamment appréciés pour s’interroger à leur sujet. Pourquoi apprécie-t-on ceux du film de Kosinski ? Parce que du début à la fin, plus de deux heures durant, l’énergie naturelle cruisienne traverse le moindre aspect du film, acteurs compris. Cette contagiosité évoquée plus haut a fait le job : tout le casting s’est très ostensiblement impliqué dans le film – le seul fait que les jeunes acteurs aient subi un entrainement intensif de plusieurs mois comme Cruise l’a lui-même fait incline par ailleurs à la bienveillance.

Ainsi Jennifer Connelly, dans le rôle de Penny, n’a-t-elle pas pour autant écopé d’un personnage pot de fleur : skippeuse amateure, elle domine l’océan dans une très belle scène, aussi physique que romantique, au côté d’un Pete cette fois-ci en position d’observateur admiratif – soit l’inverse de la fameuse scène du remake de L’Affaire Thomas Crown où Pierce Brosnan emmène Renée Russo faire un tour en catamaran, soit dit en passant. Les noms de code « Phoenix », « Hangman », « Bob » (joué par le fils de Bill Pullman, soit dit également en passant), « Payback », ou encore celui de « Hondo », le fidèle équipier de Mitchell, restent en mémoire pour une bonne raison : si les personnages secondaires n’ont pas bénéficié d’un développement digne de ce nom, ce qu’on voit d’eux fonctionne, le scénario ayant habilement géré leur caractérisation comme ça avait été encore plus le cas avec Top Gun, dont les joutes de vestiaires occupaient un pan considérable du film.

Malgré le charisme de Jennifer Connelly et les qualités de son personnage, la partie romantique aurait pu tomber à plat. Pire : on aurait pu se demander d’où elle sort. Reconnaissons qu’ôter le personnage du film n’aurait RIEN changé à l’intrigue, fondamentalement. Dans Top Gun, le personnage de Charlie, joué par Kelly McGillis, était partie intégrante de l’intrigue en sa qualité d’instructrice astrophysicienne impliquée dans les affaires de l’US Navy. Dans Top Gun : Maverick, Penny apparait à l’occasion de scènes résumables à des pauses récréatives, des temps morts auxquels elle est cantonnée, entre deux scènes d’action. C’est comme si Connelly s’était proposée tardivement, avec sa beauté à réveiller les morts, et que les gars s’étaient dit « woh putain, c’est Jennifer Connelly, faut qu’on en fasse quelque chose ». Peut-être est-ce comme ça que ça s’est passé. OU BIEN. Top Gun : Maverick, au-delà de son histoire de formation de jeunes recrues et de préparation à une opération suicide et de réconciliation entre le protagoniste et son fils spirituel, c’est l’histoire de Pete Mitchell. Et Pete Mitchell, arrivé à la cinquantaine, n’est plus le chaud lapin dont la seule vie se résumait à la piloterie… enfin, si, encore pas mal, mais ça ne pourra pas durer éternellement, et il le sent. Comme le souligne Rooster, il n’a ni épouse, ni enfants, et ce n’est pas normal. Aussi a-t-il besoin d’une famille. Sa réconciliation avec ce dernier est une étape dans cette direction ; la romance avec Penny, une mère célibataire, en est une autre. Rien n’a changé depuis dix lignes, le film aurait tenu sans elle, mais elle n’est pas aussi superflue que le suggèrent certains.
Sans être du Tolstoï, donc, Top Gun : Maverick est une upgrade indéniable, ne serait-ce que dans son écriture du rapport conflictuel entre Pete et Rooster. En gros, si Top Gun était à dix-huit années lumières de Guerre et Paix, Maverick en est à quinze. D’autant plus que Joseph Kosinski n’oubliera jamais ses personnages, comme il n’avait pas oublié un instant ceux de ses précédent films, y compris les plus digitalo-fantasmatiques comme sa suite de Tron, sur laquelle on va revenir. En parlant de lui…


Scott est mort (littéralement), vive Kosinski
Comme exprimé plus haut, je n’ai rien contre Tony Scott, cinéaste à qui je dois un de mes films préférés, True Romance – son film le moins conventionnel –, et qui, sans jamais avoir égalé son frère Ridley, a indéniablement laissé son empreinte sur le cinéma d’action hollywoodien avec la partie de sa filmo qui va des Prédateurs (1983) à USS Alabama (1995), son « âge d’or », qui inclue des classiques comme Le Flic de Beverly Hills 2 et Le Dernier Samaritain – échec en salle, culte en VHS –, ou encore le très fun Jours de Tonnerre, suite des aventures motorisées de Tom Cruise dans un cadre richement testostéroné qu’on peut voir comme une variante de Top Gun avec des voitures de course à la place des avions de chasse, la musique électrique du Hans Zimmer des années 80… et la même obsession du crépuscule artificiel. On appréciera, à ce propos, les hommages que le film a rendu à Scott en commençant et finissant leur film sur des scènes se déroulant au crépuscule, un des signes visuels distinctifs de Top Gun étant le fameux goût du réalisateur pour l’« heure magique » (oh, et l’équipage du porte-avion transpirera quand même un peu, surtout vers la fin). Le cinéma de Scott n’en est pas moins, justement, du gros ouvrage. Or Top Gun : Maverick se devait d’être non seulement plus spectaculaire, mais aussi plus perfectionné, compte tenu des exigences pratiques de sa star. À cet égard, l’annonce de Joseph Kosinski à la barre était une excellente nouvelle.

Architecte de formation devenu réalisateur par la force inspirée du destin, Kosinski a imposé son impressionnante maîtrise de l’espace cinématographique dès son premier film, le génial et terriblement sous-estimé Tron : L’Héritage, sorti en 2010, essai confirmé trois ans plus tard avec le moins génial mais quand même super-top moumoute et donc également très sous-estimé Oblivion, dans lequel une course-poursuite entre le vaisseau futuriste du héros et des drones tueurs, composée à 90% d’effets spéciaux numériques, donnait l’impression d’avoir été filmée pour de vrai de vrai (voir la vidéo ci-dessous). Ainsi son bombardement aux manettes pouvait-il être considéré comme une « upgrade », bien qu’une certaine cinéphilie considère Scott comme un génie sous-estimé sur la base de ses expérimentations des années 2000 (9). Pour paraphraser les Inconnus, il y a les bonnes expérimentations, et il y a les mauvaises expérimentations. Tron : L’Héritage en était une bonne. D’un point de vue pratique, ce nouveau Top Gun en est une, vachement beaucoup.
Et l’on ne parle pas ici d’expérimentations artistiques. Top Gun : Maverick ne se laissera à aucun moment aller à des excentricités cosmétiques, tout sera aussi bien carré, et carré en bien, que le scénario de McQ, Hollywood en pleine maîtrise de ses effets. Top Gun : Maverick, c’est l’artillerie lourde. Pas lourdingue, pas lourdaude, juste lourde. Il emballe dès son générique d’introduction, avec les noms apparaissant au rythme de la musique. Kosinski et son chef op coutumier Claudio Miranda ont choisi la photographie la moins maniérée possible pour servir l’objectif de réalisme de l’entreprise, comme ils l’avaient fait sur le modérément intéressant mais techniquement impressionnant Only the Brave, à la gloire des combattants du feu. En matière d’identité visuelle, Top Gun : Maverick arpente des sentiers déjà connus. La musique de Hans Zimmer, reconnaissable entre mille bien qu’il ne soit cette fois-ci pas seul aux crédits, illustre bien cette approche conventionnelle : en ne sortant jamais de la route, elle place le spectateur cinéphile en terrain familier. Un terrain qu’il ne s’est cependant, visiblement, pas encore lassé d’arpenter, plus de trente ans après…
On peut donc parler d’une expérimentation de chasse au réalisme susmentionné, une chasse à l’avion de chasse. Kosinski a eu une « todo-list », et il a dû assurer, et il a assuré. La façon dont le réalisateur a traduit les rêves de sa star en un film stylistiquement cohérent est remarquable. Nulle question ici de cracher sur le film de 1985 : Jerry Bruckheimer et Don Simpson, alors en pleine irrésistible ascension, avaient accompli l’exploit d’obtenir l’aide de l’US Navy, leur réalisateur avait pu mettre ses caméras sur des F-14 et un F5 déguisé en MIG-28 et filmer d’un vrai porte-avion, les grandes personnes avaient même accepté de tirer UN vrai missile rien que pour les caméras… le rendu a beau paraître vieillot de nos jours, l’exécution des scènes de combat aérien sont le résultat d’un brillant travail d’effets spéciaux pratiques. Mais le temps est le temps. Et les goûts… sont les goûts. Exemple d’upgrade gustative parmi milles autres : si Scott su chiader ses plans d’avions en action, ceux de l’intérieur des cockpits étaient assez calamiteux, alors que ceux de Top Gun : Maverick sont AU CONTRAIRE parmi ses arguments de vente. À l’instar des scènes d’action de Tron : L’Héritage et Oblivion, celles de Top Gun : Maverick sont à la fois d’un dynamisme renversant et d’une grande lisibilité, sans recours à un montage surcoupé. On aurait aimé que le cinéaste soit aux commandes de TOUS les cadrages, ce qui n’a pas été le cas puisque les plans aériens ont, de toute évidence, été filmés par des caméramen spécialisés dans l’aérien et que les plans de l’intérieur des cockpits ont été gérés par les acteurs en personnes, ne laissant à Kosinski guère d’autre choix que celui d’attendre de voir dans la salle de montage ; de toute évidence, l’expérience a dû être très différente de celle du tournage de Tron : L’Héritage et Oblivion, où tout était sous son contrôle. Mais le film présente tous les signes d’un travail de storyboard d’une grande rigueur, les plans somptueux qu’on lui a ramenés de chaque petite sortie supersonique ont clairement été suffisants, force est de reconnaitre que les acteurs ont su assurer sur tous les plans (ho ho ho), et les CGI n’ont fait qu’élever la puissance visuelle de l’ensemble – le plan précité de la « formation diamond » a beau être composé en partie de CGI, il n’en reste pas moins sensationnel en terme de composition. Le puissant crescendo dramatique qui prépare le troisième acte, c’est Kosinski. Top Gun : Maverick n’est pas un film de Tom Cruise qui se serait servi du gars comme d’un vulgaire « yes man » caméraman. Autant dire que la partie « behind-the-scenes » du blu-ray aura intérêt à durer plus de huit heures, fourchette basse.


Ni nombrilisme, ni nostalgie
Compte tenu de la nature de boyscout de ce cher Tom – ne pas oublier qu’il a failli rentrer dans les ordres –, on pouvait vaguement craindre du film qu’il en fasse des caisses avec sa propre « mythologie ». Il n’en est rien. Les Ray-Ban aviator, les cinquante écussons du blouson, une partie de beach volley en hommage à celle de volley ball restée dans les mémoires, et même la très ingénieuse remise en service temporaire du fameux F-14 dans le dernier acte seront les manifestations d’un fan-service inoffensif auquel même le non-fan réagira par un grand sourire. La photo du coéquipier mort dans le casier de Pete (la photo, pas le coéquipier) est entièrement justifiée puisque le nœud dramatique du film, le rapport conflictuel entre son fils Rooster et Pete Mitchell, découle de cette mort, donc rien à dire de ce côté non plus. Enfin, l’idée pour une suite de donner corps à un personnage seulement mentionné précédemment, en l’occurrence Penny Benjamin, fille d’amiral, est une bien jolie idée, assez rarement vue au cinéma.


Le seul risque résidait dans l’implication de Val Kilmer, interprète du fameux rival du héros dans Top Gun, un Val Kilmer aujourd’hui rendu muet par un cancer de la gorge – les quelques mots qu’on croit l’entendre prononcer à la fin de sa scène ont en fait été ajoutés en post-production en utilisant sa voix reconstruite par intelligence artificielle. Il est difficile de ne pas « voir » les intentions, alors même que se joue la scène, de ne pas imaginer Tom Cruise insistant pour impliquer l’acteur dans l’entreprise, par principe, par éthique, en mode « tu tombes, on tombe ». Mais « voir » les intentions n’est vraiment problématique que si l’exécution de la scène en est la cause, or ce n’est pas le cas ici. Par ailleurs, la façon dont McQ justifie scénaristiquement son implication dans l’intrigue est imparable. Certains trouveront tarte malgré tout la scène entre Cruise et Kilmer ; tant pis pour eux.
Une autre qualité du film est que la fine équipe n’a pas cédé à la facilité du « revival 80’s » – de moins en moins à la mode, comme en atteste le regrettable parcours de Stranger Things. Quelques éléments lorgnent de ce côté, tout au plus. Cette discrète brillance de la photographie, qui rappelle le cinéma hollywoodien de l’époque. La reprise du thème musical, qui coule de source. La balade pas inoubliable mais assez emballante de Lady Gaga, qui, si l’on omet l’auto-tune pourri du début et les vagues airs de Let it go, rappelle positivement cette époque où pas mal de gros films hollywoodiens se finissaient sur une chanson originale, comme celles composées, justement, par Hans Zimmer. Enfin, et là, c’est une petite fixette personnelle dont la plupart des gens se foutront mais c’est ma critique : l’apparition de chaque acteur avec son nom au début du générique de fin, figure de style trop rare qui m’a rappelé Platoon. Chacun de ces éléments produit indéniablement son petit effet sur le cinéphile nostalgique, mais additionnés, ils ne représentent pas grand-chose, et c’est tant mieux.

Pas le temps d’être sexy
Une autre différence notable entre Top Gun : Maverick et le premier film tient à leur degré de sensualité. Top Gun, ce sont donc les combats aériens et les joutes homoérotiques de vestiaires (10), assurément, mais c’est aussi un Tom Cruise tout moite emballant une très émoustillée Kelly McGillis sur le très romantique Take my breath away des Righteous Brothers dans des plans de pub Calvin Klein, comme je le disais plus haut. Il n’y a pas de cul, ce ne sont pas les années 80 dans leur plus glorieuse impudeur, mais c’est SEXY comme elles savaient l’être naturellement.
Dans le film de Kosinski, il y a bien une romance, une qui a une certaine gueule compte tenu de ses deux interprètes, et le fait que le personnage de Penny Benjamin ait été mentionné dans le film de Scott ajoute un je-ne-sais-quoi (à prononcer avec l’accent américain) d’aguicheur à l’ensemble, peut-être parce que ça renvoie au souvenir de la Jennifer jeune (aaaah, Some Girls !)… mais tout cela reste quand même bien prude. On n’a même pas droit à un bisou, quoi. Prude comme la plupart des films de Tom Cruise depuis un moment, quand on y pense – à quand remonte sa dernière scène de papouilles un minimum graphique ? 2013, avec celle d’Oblivion, avec Andrea Risborough ? Les jeunots ne sont d’aucune aide puisqu’on ne s’arrête pas un instant sur leur vie privée, parents, tendres moitiés, animaux de compagnie, rien. Acceptons donc que Top Gun : Maverick est un film BIEN trop occupé par sa célébration de l’héroïsme et de l’aviation pour se laisser aller à de tels enfantillages, et que la romance avec Penny Benjamin n’est là que pour explorer, substantiellement mais brièvement, un aspect de son héros. Rien de mal en soi.

Top moumoute
Top Gun : Maverick est décidément en phase avec son temps : plus nostalgique, moins original, moins sexy. Mais une histoire d’accomplissement de soi et de réconciliation quasi-familiale peut se dispenser de sensualité, un Tom Cruise compense tous les élans nostalgiques du monde par son regard d’acier pointé vers l’avenir, quant à l’originalité, l’effet bœuf que parvient à produire le film MALGRÉ la prévisibilité de son scénario bourré de joyeux archétypes n’est rien de moins que le témoignage de la grandeur du reste, de TOUT LE RESTE. C’est un accomplissement technique et formel exaltant qui rappelle celui de Mad Max : Fury Road sans souffrir de la comparaison, un des meilleurs seconds volets du cinéma, et probablement le plus beau « legacyquel » qu’Hollywood nous ait offerts, parce qu’également plein d’un cœur battant à tout rompre. Parce que Tom Cruise dans Top Gun : Maverick, ce n’est pas Schwarzenegger dans Terminator : Dark Fate, ni Harrison Ford dans Star Wars : Le Réveil de la force, ni Sam Neill dans le nouveau Jurassic World, ni le casting original décrépit arrivant à la fin d’SOS Fantômes : L’Héritage. Ce n’est pas du recyclage commercial. C’est de la passion chimiquement pure. C’est l’exécution d’une ambition individuelle sans compromis – sinon celui de ne pas piloter pour de bon des F-18, c’est bon, on a compris. C’est triomphe de la volonté de divertir.
Réussissant l’exploit d’en mettre DAVANTAGE encore plein la vue que Fallout DEUX ANS plus tard (puisqu’il était prêt à sortir en 2020), Top Gun : Maverick a intégré le top 5 de mes films préférés de sa filmographie au côté d’Entretien avec un vampire, Collateral, Mission impossible – Rogue Nation, et Risky Business (c’est MA liste)… Eyes Wide Shut, Jerry Maguire et Edge of Tomorrow n’étant pas loin derrière.
« The future is coming, and you’re not in it », dit l’amiral Cain – génial Ed Harris – à Pete Mitchell au début du film. Rien ne caractérise moins bien ce dernier. Et heureusement pour le cinéma hollywoodien, rien ne caractérise moins bien Tom Cruise non plus.


Notes
(1) Top Gun : Maverick n’étant ni une production Disney ni un film Netflix ou Amazon prime, il a eu le bon goût de ne rien proposer de « woke ». Les personnages joués par des acteurs noirs ne mentionneront pas une seule fois leur couleur de peau, le personnage de la fille pilote ne sortira à aucun moment une réplique débile du genre de « qu’est-ce qu’il y a, Hangman, t’as peur d’une femme forte et indépendante ? », on est à mille lieues de la propagande déconstructrice revancharde comme on en trouve dans le Doctor Who actuel. Pour autant, le film de Kosinski a fait de la discrimination positive avec un zèle tout particulier. Considérant que les effectifs de l’US Navy sont à 54% des minorités raciales et à 20% des femmes, on pourrait penser que le film a simplement été fidèle à la réalité… mais ce sont les statistiques des pilotes de combat qui comptent, et elles nous apprennent que seuls 2% d’entre eux sont « afro-américains » et 12% de sexe féminin. Ainsi, avec la quasi-moitié de ses pilotes blacks ou hispano, Top Gun : Maverick a indéniablement distordu la réalité au nom de l’inclusivité. Le personnage de la fille pilote n’est en revanche pas critiquable pour cette raison, d’abord parce qu’il témoigne de la présence bien réelle de femmes pilotes dans l’US Navy, ensuite parce que ça valait le coup, pour finir, parce que l’actrice est top.
(2) Après tout, la date de sortie avait déjà été reportée de l’été 2019 à l’été 2020, donc pré-COVID, pour les mêmes raisons de peaufinage…
(3) La question est : comment situer la frontière entre le recours justifié et le recours excessif aux CGI ? Question plus intéressante encore : comment identifier les films de SF ou d’épouvante qui auraient pu s’en passer ? Le Seigneur des anneaux aurait-il pu se faire vingt ans plus tôt ? Le spectacle aurait-il perdu à ce point de son spectaculaire (quoiqu’on parle d’un film riche en effets de trompe-l’œil…) ? Combien de films n’auraient littéralement pas pu exister sans eux, tel Jurassic Park, où tout n’aurait pas pu être en animatronique ? Quelqu’un connaitrait-il une lecture à ce sujet ?
(4) Il est intéressant de noter que Cruise n’a pas encore joué de « vieux », la plupart des personnages qu’il a joué n’ont pas d’enfants, Eyes Wide Shut, La Guerre des mondes (où ça ne marchait pas totalement) et Barry Seal : American Traffic étant les trois seuls exemples qui viennent en tête.
(5) Maintenant que j’y pense, Jeremy Renner était déjà la tête d’affiche de Jason Bourne : L’Héritage… ouais, bon, on va éviter.
(6) La période qui sépare Rogue Nation de Fallout n’a pas été la plus féconde de sa filmo, avec deux mauvais films sur trois (la suite de Jack Reacher et La Momie, le troisième étant le sympathique Barry Seal), mais comme dit plus haut, on parle d’un acteur dont seuls 23% de la filmo est à jeter, et ça inclut ses tous premiers films, pré-Risky Business, dont la médiocrité est par conséquent négligeable car la majorité des carrières de grands acteurs commencent par une majorité de films tout au plus oubliables. Depuis sa révélation dans Risky Business, je ne compterai, personnellement, que sept ratés, Legend, Cocktail (que j’ai toujours trouvé fun cela dit), Horizons lointains, Mission impossible 2, Lions et Agneaux, Jack Reacher : Never Go Back, et La Momie, et il est carrément probable que le gars n’ait tourné ce dernier QUE pour la scène en apesanteur.
(7) Le génial Les Grossman de Tonnerre sous les Tropiques est, à mon sens, bien trop drôle et bien trop peu présent pour être considéré comme un antagoniste.
(8) Le premier Top Gun dure 1h50. Autre époque. Autre film, aussi.
(9) Principalement le Tony Scott des années 2000, celui des expérimentations formelles du type de Domino, Déjà vu et Unstoppable, accroché à Denzel Washington comme une moule à son rocher – expérimentations formelles à mon sens foireuses ET dangereuses pour les épileptiques, ces films faisant passer Michael Bay pour un réalisateur flamand de la Nouvelle vague en comparaison.
(10) Personne n’expliquera mieux ça que Quentin Tarantino dans le film Sleep With Me (1994).
– Ci-dessous, quelques captures d’écran supplémentaires, en attendant de supplémentaires supplémentaires lorsque j’aurais le blu-ray 4k du film.










