
Mon top 10 de l’année 2023
Un bien déconcertante année, sur le plan cinéphilique, que l’année 2023, dont SI PEU des films sanctifiés par la critique m’ont convaincu, que ce soit le Nolan, le Scorsese, le Spielberg, le Miyazaki (brrrr), le Barbie (double-brrrr), le nouveau Spider-Verse, ou même l’objectivement réussi Anatomie d’une chute, que pour la première fois de ma vie, j’ai été contraint de me livrer à des séances de rattrapage massives en fin d’année, et de piocher dans un cinéma vu par TOUT AU PLUS trente pèlerins, familles des réalisateurs incluses, pour obtenir un top 10 à peu près satisfaisant.
L’année avait pourtant très bien démarré, avec le très clivant mais aussi très génial Babylon, de Damien Chazelle, l’atmosphérique La Montagne, de Thomas Salvador, et le bouleversant Aftersun, de Charlotte Wells… le printemps avait à peine commencé que je découvrais l’encore plus bouleversant The Quiet Girl, qui complétait mon top 3 avec Babylon et Aftersun, top 3 qui resterait inchangé les neuf mois suivants… c’est après, que ça s’est compliqué, notamment en milieu d’année, avec la légère déception qu’a été Mission impossible : Dead Reckoning (quoique ma tomcruisophilie aigüe a fini par l’intégrer au top), le pénible phénomène estival « Barbenheimer » (censé marquer le « retour du cinéma » !), ou encore mon manque d’enthousiasme vis-à-vis de chouchous de la critique comme le déjà mentionné Anatomie d’une chute ou encore Yannick. Mais que voulez vous ? « Chacun sa route, chacun son chemin », comme dit si justement la chanson d’Un Indien dans la ville. Et ça ne m’a pas empêché de bricoler un top 10.
Remarque : je n’ai vu ni Le Ravissement, ni L’Arbre aux papillons d’or, ni Les Herbes sèches (n’ayant pas 3h15 de libres sur moi), ni L’Été dernier, ni Vers un avenir radieux, ni La Passion du dindon bouffi. Peut-être ces films loués par la critique auraient-ils leur place dans ledit top si j’avais pris le temps de les visionner, qui sait ? Comme dit le Joker dans Batman, tant de choses à faire et si peu de temps.
Au programme de ce soir, donc : trois films français, Le Gang des Bois du Temple, Le Théorème de Marguerite et La Montagne ; trois films américains, Mission impossible : Dead Reckoning, Reality et Babylon ; un film anglais, Aftersun ; un film irlandais, The Quiet Girl ; et un film sud-coréen, About Kim Sohee, pour bien signifier aux gens que je ne suis pas raciste, contrairement à ce que disent les gens à la radio. Ni misogyne : trois films sur dix ont été mis en scène par des réalisatric.e.s ! Si ce n’est pas formidable. Pour finir, aucun d’eux n’est une maudite sortie de plateforme de streaming. Non, franchement, si tout ça ne peut pas redorer mon blason, c’est décidé, plus rien en ce monde n’a de sens. Allez, c’est parti.
Sommaire
Le top 10
10. LE GANG DES BOIS DU TEMPLE
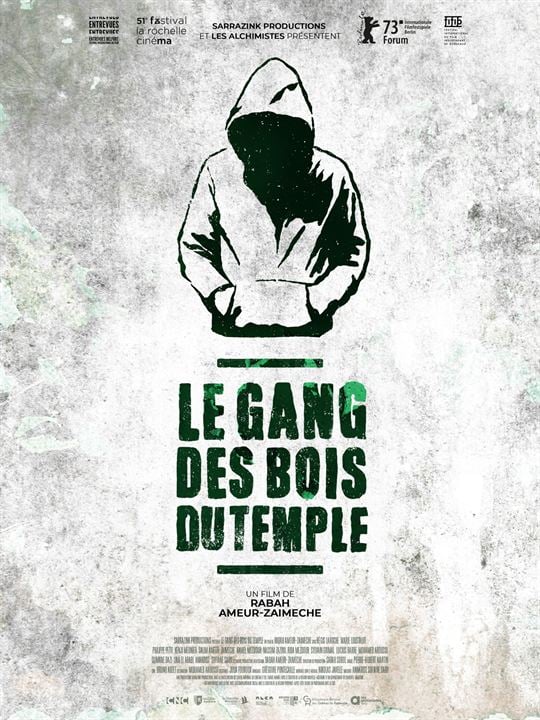 Un grand merci à l’ami qui m’a motivé pour passer OUTRE l’affiche complètement pourrie du film de Rabah Ameur-Zaïmeche (RAZ), qui donne l’impression d’avoir affaire à un film de weshs… alors que le gang du Gang est AU CONTRAIRE un de la vieille école, une bande de « darons » en partie français de souche, exempts de cette affreuse affrication, et davantage vêtus de blousons noirs que de survêts Lacoste, soulignant la référence de RAZ au polar français des années 70. Le (seul) bon côté de l’affiche est qu’on n’y voit pas l’ombre d’un flic, puisqu’on n’en verra effectivement pas un seul. C’est une histoire de gentils méchants qui se frottent sans le savoir à des méchants méchants et paf le chien, end credits. Pas de préparation minutieuse du braquage, ni d’enquête de police consécutive, parce que pas besoin : l’intérêt du Gang réside dans sa brillante mise en scène, hyper-immersive, tout juste coupable d’étirer ses scènes en longueur, davantage que dans son scénario, qui s’avère des plus sommaires. En fait, ce dernier est même miné par quelques facilités et approximations, comme la façon dont le personnage de Pons s’intègre magiquement à l’intrigue, qui auraient carrément endommagé le film sans le CARACTÈRE de cette mise en scène, qu’on retrouve dans la direction d’acteurs, inspirée, à laquelle on doit la découverte de deux « gueules » (celles de Régis Laroche et Philippe Petit). Cet aspect fondamental du Gang en fait moins un film de braquage à l’américaine qu’un drame social dont l’authenticité a, par endroits, un pouvoir de sidération (mention à la scène du bar-PMU, par exemple) (et c’est d’ailleurs mieux comme ça, parce que RAZ n’est pas très bon à filmer les fusillades, on ne pige rien à ce qui se passe dans la sienne, même avec l’argument de la nuit noire !). Ce sont les atmosphères, l’authenticité de ces atmosphères donnant vie à cette « téci » partagée entre la sinistrose ambiante et une certaine conscience de communauté salutaire, et la vérité des moments entre hommes saisis à la volée, comme l’introduction du gang dans la joyeuse scène du garage, qui font la beauté minérale de cet impressionnant film rempli de scènes mémorables (le chant de la vieille femme à l’enterrement, la danse du prince dans la boîte de nuit, l’assassinat dans la cour de la prison sous la clameur…). La seule chose à accepter, c’est la GENTILLESSE de nos gentils méchants sur laquelle compte le postulat du film : qui dit « social » dit « propos », et le propos de RAZ, prompt à réjouir le critique de L’Huma, suggère qu’avec une juste redistribution de la richesse, tous ces gangsters de « téci » se mettraient poliment au vert, puisqu’ils ont tous INVARIABLEMENT le cœur sur la main. Un peu gros ? Un peu gros. Mais ça ne pose pas pour autant de problème de réalisme, alors oublions un peu la politique, et « contentons-nous » du cinéma avec un grand C.
Un grand merci à l’ami qui m’a motivé pour passer OUTRE l’affiche complètement pourrie du film de Rabah Ameur-Zaïmeche (RAZ), qui donne l’impression d’avoir affaire à un film de weshs… alors que le gang du Gang est AU CONTRAIRE un de la vieille école, une bande de « darons » en partie français de souche, exempts de cette affreuse affrication, et davantage vêtus de blousons noirs que de survêts Lacoste, soulignant la référence de RAZ au polar français des années 70. Le (seul) bon côté de l’affiche est qu’on n’y voit pas l’ombre d’un flic, puisqu’on n’en verra effectivement pas un seul. C’est une histoire de gentils méchants qui se frottent sans le savoir à des méchants méchants et paf le chien, end credits. Pas de préparation minutieuse du braquage, ni d’enquête de police consécutive, parce que pas besoin : l’intérêt du Gang réside dans sa brillante mise en scène, hyper-immersive, tout juste coupable d’étirer ses scènes en longueur, davantage que dans son scénario, qui s’avère des plus sommaires. En fait, ce dernier est même miné par quelques facilités et approximations, comme la façon dont le personnage de Pons s’intègre magiquement à l’intrigue, qui auraient carrément endommagé le film sans le CARACTÈRE de cette mise en scène, qu’on retrouve dans la direction d’acteurs, inspirée, à laquelle on doit la découverte de deux « gueules » (celles de Régis Laroche et Philippe Petit). Cet aspect fondamental du Gang en fait moins un film de braquage à l’américaine qu’un drame social dont l’authenticité a, par endroits, un pouvoir de sidération (mention à la scène du bar-PMU, par exemple) (et c’est d’ailleurs mieux comme ça, parce que RAZ n’est pas très bon à filmer les fusillades, on ne pige rien à ce qui se passe dans la sienne, même avec l’argument de la nuit noire !). Ce sont les atmosphères, l’authenticité de ces atmosphères donnant vie à cette « téci » partagée entre la sinistrose ambiante et une certaine conscience de communauté salutaire, et la vérité des moments entre hommes saisis à la volée, comme l’introduction du gang dans la joyeuse scène du garage, qui font la beauté minérale de cet impressionnant film rempli de scènes mémorables (le chant de la vieille femme à l’enterrement, la danse du prince dans la boîte de nuit, l’assassinat dans la cour de la prison sous la clameur…). La seule chose à accepter, c’est la GENTILLESSE de nos gentils méchants sur laquelle compte le postulat du film : qui dit « social » dit « propos », et le propos de RAZ, prompt à réjouir le critique de L’Huma, suggère qu’avec une juste redistribution de la richesse, tous ces gangsters de « téci » se mettraient poliment au vert, puisqu’ils ont tous INVARIABLEMENT le cœur sur la main. Un peu gros ? Un peu gros. Mais ça ne pose pas pour autant de problème de réalisme, alors oublions un peu la politique, et « contentons-nous » du cinéma avec un grand C.




09. LE THÉORÈME DE MARGUERITE
 Ce petit Théorème de Marguerite, autre film français de 2023 trèèèèès probablement passé sous votre radar, mérite pourtant largement sa chance : surmontez son premier quart d’heure, pas hyper-engageant parce qu’un peu austère, austère comme son héroïne campée par une formidable Ella Rumpf à la beauté pas DU TOUT mise en valeur – je me demandais si c’était le nouveau La Voie royale version autiste –, voyez ladite Marguerite craquer son slip comme ce n’est PAS censé arriver dans les parcours universitaires de génies comme elle et se réfugier en loucedé dans l’électrique quartier chinois du 13ème arrondissement de Paris, et ayez confiance en ce qui en résultera, notamment l’humanité toute en retenue du film. C’est un drame introspectif TRÈS surprenant, d’abord par son identité visuelle forte, la réalisatrice Anna Novion et son chef op enchaînant les plans magnifiquement composés aux chaudes couleurs (et jouant beaucoup avec les reflets sur les lunettes de l’héroïne), ensuite par… son héroïne, finalement très touchante à mesure qu’elle se découvre, ensuite par son propos intelligent sur l’apport de l’émotionnel et sur l’intelligence du cœur. Ce n’est pas parfait, hein, on aurait aimé que l’assez divertissante partie consacrée au mahjong ait des conséquences plus substantielles sur la trame scénaristique plutôt que d’être une simple étape, et que le quartier chinois soit davantage exploré (l’auteur de ces lignes parle en natif…), et le personnage bien sexy de la coloc Noa (Sonia Bonny officiellement repérée) est un peu sacrifié dans le dernier acte au profit de la romance… mais bordel, Novion a su toucher au cœur, avec son héroïne pourtant difficile d’accès. Captiver avec un portrait d’autiste n’est pas un maigre challenge, mais elle y est parvenue haut la main, parce qu’elle l’a, de toute évidence, cernée dès le début (et puis, lui donner pour mère l’éternellement craquante Clotilde Courau a aidé). Son film brille par sa capacité à jongler entre des moments de tension dramatique et des instants de douceur, notamment entre Marguerite et Lucas, et à connecter émotionnellement le public à sa quête du théorème grâce à son utilisation graphique de l’appartement, VRAIE découverte, limite un personnage à part entière (n’oublions pas non plus que la présence de Jean-Pierre Darroussin dans un film augmente de 300% son degré de réalisme). La jolie musique de Pascal Bideau, à la fois discrète et pleine d’un doux romantisme, accompagne parfaitement la complexité des émotions de l’héroïne, jusqu’à un dénouement joliment optimiste qui donne l’impression au spectateur de voir le théorème… non pas de Marguerite, mais du FILM-même, un film également pensé comme une déclaration, un brin solennelle, du besoin de l’Autre. C’est cette âme, que le film de Novion possède alors qu’elle fait cruellement défaut à tant d’autres œuvres similaires, et ce qu’Ella Rumpf en a fait (je SAVAIS qu’elle irait loin en matant Grave !), qui l’ont placée dans ce top annuel. « Les mathématiques ne doivent souffrir d’aucun sentiment », disiez-vous ?
Ce petit Théorème de Marguerite, autre film français de 2023 trèèèèès probablement passé sous votre radar, mérite pourtant largement sa chance : surmontez son premier quart d’heure, pas hyper-engageant parce qu’un peu austère, austère comme son héroïne campée par une formidable Ella Rumpf à la beauté pas DU TOUT mise en valeur – je me demandais si c’était le nouveau La Voie royale version autiste –, voyez ladite Marguerite craquer son slip comme ce n’est PAS censé arriver dans les parcours universitaires de génies comme elle et se réfugier en loucedé dans l’électrique quartier chinois du 13ème arrondissement de Paris, et ayez confiance en ce qui en résultera, notamment l’humanité toute en retenue du film. C’est un drame introspectif TRÈS surprenant, d’abord par son identité visuelle forte, la réalisatrice Anna Novion et son chef op enchaînant les plans magnifiquement composés aux chaudes couleurs (et jouant beaucoup avec les reflets sur les lunettes de l’héroïne), ensuite par… son héroïne, finalement très touchante à mesure qu’elle se découvre, ensuite par son propos intelligent sur l’apport de l’émotionnel et sur l’intelligence du cœur. Ce n’est pas parfait, hein, on aurait aimé que l’assez divertissante partie consacrée au mahjong ait des conséquences plus substantielles sur la trame scénaristique plutôt que d’être une simple étape, et que le quartier chinois soit davantage exploré (l’auteur de ces lignes parle en natif…), et le personnage bien sexy de la coloc Noa (Sonia Bonny officiellement repérée) est un peu sacrifié dans le dernier acte au profit de la romance… mais bordel, Novion a su toucher au cœur, avec son héroïne pourtant difficile d’accès. Captiver avec un portrait d’autiste n’est pas un maigre challenge, mais elle y est parvenue haut la main, parce qu’elle l’a, de toute évidence, cernée dès le début (et puis, lui donner pour mère l’éternellement craquante Clotilde Courau a aidé). Son film brille par sa capacité à jongler entre des moments de tension dramatique et des instants de douceur, notamment entre Marguerite et Lucas, et à connecter émotionnellement le public à sa quête du théorème grâce à son utilisation graphique de l’appartement, VRAIE découverte, limite un personnage à part entière (n’oublions pas non plus que la présence de Jean-Pierre Darroussin dans un film augmente de 300% son degré de réalisme). La jolie musique de Pascal Bideau, à la fois discrète et pleine d’un doux romantisme, accompagne parfaitement la complexité des émotions de l’héroïne, jusqu’à un dénouement joliment optimiste qui donne l’impression au spectateur de voir le théorème… non pas de Marguerite, mais du FILM-même, un film également pensé comme une déclaration, un brin solennelle, du besoin de l’Autre. C’est cette âme, que le film de Novion possède alors qu’elle fait cruellement défaut à tant d’autres œuvres similaires, et ce qu’Ella Rumpf en a fait (je SAVAIS qu’elle irait loin en matant Grave !), qui l’ont placée dans ce top annuel. « Les mathématiques ne doivent souffrir d’aucun sentiment », disiez-vous ?




08. LA DERNIÈRE REINE
 Une des claques de l’année… d’autant plus qu’elle a surgi de nulle part, d’autant plus que c’est un PREMIER long-métrage. Tout entier consacré au pouvoir de fascination de la figure de la reine Zaphira, lovée entre réalité et légende, esthétiquement renversant, débordant d’énergie filmique, magnétique comme son personnage de Barberousse, interprété avec fougue par un casting de belles gueules, ensorcelant comme ses somptueux décors naturels, d’une ampleur romanesque inattendue, d’une élégance et même d’une sensualité folles, et flanqué d’une Nadia Tereszkiewicz irrésistible en pirate sexy : que l’Algérie ait pu – en majeure partie – concevoir une telle œuvre a littéralement failli retourner le cerveau de votre serviteur. La Dernière reine est une véritable claque visuelle (la bataille sauvage du début, le faste de la cour, la rencontre entre le roi et Barberousse, la nuit de l’assassinat avec ses corridors éclairés à la lumière naturelle, l’envoûtante scène du voile dont se sert l’affiche du film…), chaque plan semblant soigneusement composé pour capturer ce que l’Algérie a de plus photogénique, que ce soit dans ses décors naturels, à la fois majestueux et sauvages, vastes étendues désertiques, montagnes escarpées, forêts luxuriantes et cette mer parfaitement bleue ajoutant, étrangement, à la dimension épique de l’aventure, ou dans ses intérieurs, tous d’authentiques lieux, palais richement détaillés et marchés gorgés de vie reflétant une culture et une histoire profondément enracinées, le tout plongé dans une atmosphère onirique par des jeux de couleur qui transportent le spectateur dans un autre monde (qui a dit qu’on avait besoin de Dune ?). Le personnage de Barberousse a été évoqué : la performance de son interprète, Dali Benssalah, déjà remarqué, quelques mois plus tôt, dans le très fort Je verrai toujours vos visages, illustre parfaitement le charisme du film de Damien Ounouri et Adila Bendimerad, qui joue la dernière reine du titre (!). Leur épopée marie romantisme et sens du tragique d’une façon rappelant l’oeuvre de Shakespeare tout en apportant une perspective moderne et féministe… mais d’un féminisme NON pollué par la névrose identitaire actuelle, un féminisme qui se concentre sur la force intérieure des personnages féminins sans jamais céder aux facilités. On ne peut s’empêcher de rêver à ce que donnerait l’univers du film déployé dans une série de huit-dix épisodes : un équivalent maghrébin à la légendaire série Game of Thrones.
Une des claques de l’année… d’autant plus qu’elle a surgi de nulle part, d’autant plus que c’est un PREMIER long-métrage. Tout entier consacré au pouvoir de fascination de la figure de la reine Zaphira, lovée entre réalité et légende, esthétiquement renversant, débordant d’énergie filmique, magnétique comme son personnage de Barberousse, interprété avec fougue par un casting de belles gueules, ensorcelant comme ses somptueux décors naturels, d’une ampleur romanesque inattendue, d’une élégance et même d’une sensualité folles, et flanqué d’une Nadia Tereszkiewicz irrésistible en pirate sexy : que l’Algérie ait pu – en majeure partie – concevoir une telle œuvre a littéralement failli retourner le cerveau de votre serviteur. La Dernière reine est une véritable claque visuelle (la bataille sauvage du début, le faste de la cour, la rencontre entre le roi et Barberousse, la nuit de l’assassinat avec ses corridors éclairés à la lumière naturelle, l’envoûtante scène du voile dont se sert l’affiche du film…), chaque plan semblant soigneusement composé pour capturer ce que l’Algérie a de plus photogénique, que ce soit dans ses décors naturels, à la fois majestueux et sauvages, vastes étendues désertiques, montagnes escarpées, forêts luxuriantes et cette mer parfaitement bleue ajoutant, étrangement, à la dimension épique de l’aventure, ou dans ses intérieurs, tous d’authentiques lieux, palais richement détaillés et marchés gorgés de vie reflétant une culture et une histoire profondément enracinées, le tout plongé dans une atmosphère onirique par des jeux de couleur qui transportent le spectateur dans un autre monde (qui a dit qu’on avait besoin de Dune ?). Le personnage de Barberousse a été évoqué : la performance de son interprète, Dali Benssalah, déjà remarqué, quelques mois plus tôt, dans le très fort Je verrai toujours vos visages, illustre parfaitement le charisme du film de Damien Ounouri et Adila Bendimerad, qui joue la dernière reine du titre (!). Leur épopée marie romantisme et sens du tragique d’une façon rappelant l’oeuvre de Shakespeare tout en apportant une perspective moderne et féministe… mais d’un féminisme NON pollué par la névrose identitaire actuelle, un féminisme qui se concentre sur la force intérieure des personnages féminins sans jamais céder aux facilités. On ne peut s’empêcher de rêver à ce que donnerait l’univers du film déployé dans une série de huit-dix épisodes : un équivalent maghrébin à la légendaire série Game of Thrones.




07. ABOUT KIM SOHEE
 « Cet environnement n’est bon pour PERSONNE. » Voilà. C’est dit. Avec la force de frappe rageuse et révoltée d’un GRAND film social, appel à la prise de conscience et à l’action face à une injustice trop longtemps ignorée, traité sur le mode du docu-fiction, sans esbroufe visuelle ni surplus de musique émotionnellement manipulatrice – la chaleur d’un rayon de soleil est peut-être le seul élément poétique de la mise en scène au cordeau de July Jung. C’est franc du collier, c’est grave sans être misérabiliste… et c’est un énième film de cette liste à être passé inaperçu dans l’hexagone, alors que son sujet, le harcèlement moral au travail, touche TOUT pays au monde, à commencer par ceux où préside l’idéologie ultralibérale de la compétition pour le rendement, la maximisation, et tout le tralala. La radioscopie de ce mal systémique à laquelle se livre About Kim Sohee est remarquable, chaque étape du processus de déshumanisation étant examinée avec une minutie exténuante. Du début à la fin, on assiste, impuissant, au processus d’aliénation et d’enfermement de la jeune employée dans un état de culpabilisation et de rancœur permanentes (« si tu n’assures pas, tu vas entraîner les autres avec toi ») et une culture de l’humiliation gangrenant les relations professionnelles (personne ne veut être traité ainsi, DONC tout le monde trime sans relâche, peu importe que ce soit injuste). Ce n’est pas le visionnage le plus aisé, d’autant que la première partie est lente et parfois volontairement pénible, mais ce parti pris radical sert parfaitement le propos du film, qui est de mettre en lumière un sujet FAIT pour révolter toute personne dotée d’un semblant de conscience – contrairement à certains des fils de pute d’adultes que croise la jeune fille. Chaque scène est minutieusement construite pour provoquer une réaction, que ce soit la colère, la tristesse ou l’indignation. July Jung ne se contente pas de dénoncer un système, elle nous fait ressentir l’inhumanité de ce dernier dans chaque interaction et chaque décision à travers une mise en scène d’une précision chirurgicale, dont l’économie d’artifice renforce le sentiment d’authenticité. La descente aux enfers de Sohee est ainsi autrement plus convaincante que celle de la minette de 13 Reasons Why, par exemple, car elle est dépeinte avec une précision et une clarté qui rendent sa mort inévitable. Par ailleurs, la deuxième partie du film récompense au CENTUPLE le spectateur : menée d’une main de fer par l’inspectrice jouée avec une belle détermination par la grande Bae Doo-Na, elle a, pour le spectateur révolté, une dimension puissamment cathartique : en Bae, on peut voir la cinéaste elle-même, passant une heure à être sidérée par ce sinistre fait divers qu’elle a dû s’approprier – autant dire que la durée de 2h20 est entièrement justifiée. Au passage, privilégier le titre international au titre franglais débile : Next Sohee, littéralement « la prochaine Sohee », suggère que ce qui lui est arrivé arrivera à d’autres si rien n’est fait.
« Cet environnement n’est bon pour PERSONNE. » Voilà. C’est dit. Avec la force de frappe rageuse et révoltée d’un GRAND film social, appel à la prise de conscience et à l’action face à une injustice trop longtemps ignorée, traité sur le mode du docu-fiction, sans esbroufe visuelle ni surplus de musique émotionnellement manipulatrice – la chaleur d’un rayon de soleil est peut-être le seul élément poétique de la mise en scène au cordeau de July Jung. C’est franc du collier, c’est grave sans être misérabiliste… et c’est un énième film de cette liste à être passé inaperçu dans l’hexagone, alors que son sujet, le harcèlement moral au travail, touche TOUT pays au monde, à commencer par ceux où préside l’idéologie ultralibérale de la compétition pour le rendement, la maximisation, et tout le tralala. La radioscopie de ce mal systémique à laquelle se livre About Kim Sohee est remarquable, chaque étape du processus de déshumanisation étant examinée avec une minutie exténuante. Du début à la fin, on assiste, impuissant, au processus d’aliénation et d’enfermement de la jeune employée dans un état de culpabilisation et de rancœur permanentes (« si tu n’assures pas, tu vas entraîner les autres avec toi ») et une culture de l’humiliation gangrenant les relations professionnelles (personne ne veut être traité ainsi, DONC tout le monde trime sans relâche, peu importe que ce soit injuste). Ce n’est pas le visionnage le plus aisé, d’autant que la première partie est lente et parfois volontairement pénible, mais ce parti pris radical sert parfaitement le propos du film, qui est de mettre en lumière un sujet FAIT pour révolter toute personne dotée d’un semblant de conscience – contrairement à certains des fils de pute d’adultes que croise la jeune fille. Chaque scène est minutieusement construite pour provoquer une réaction, que ce soit la colère, la tristesse ou l’indignation. July Jung ne se contente pas de dénoncer un système, elle nous fait ressentir l’inhumanité de ce dernier dans chaque interaction et chaque décision à travers une mise en scène d’une précision chirurgicale, dont l’économie d’artifice renforce le sentiment d’authenticité. La descente aux enfers de Sohee est ainsi autrement plus convaincante que celle de la minette de 13 Reasons Why, par exemple, car elle est dépeinte avec une précision et une clarté qui rendent sa mort inévitable. Par ailleurs, la deuxième partie du film récompense au CENTUPLE le spectateur : menée d’une main de fer par l’inspectrice jouée avec une belle détermination par la grande Bae Doo-Na, elle a, pour le spectateur révolté, une dimension puissamment cathartique : en Bae, on peut voir la cinéaste elle-même, passant une heure à être sidérée par ce sinistre fait divers qu’elle a dû s’approprier – autant dire que la durée de 2h20 est entièrement justifiée. Au passage, privilégier le titre international au titre franglais débile : Next Sohee, littéralement « la prochaine Sohee », suggère que ce qui lui est arrivé arrivera à d’autres si rien n’est fait.




06. MISSION IMPOSSIBLE : DEAD RECKONING
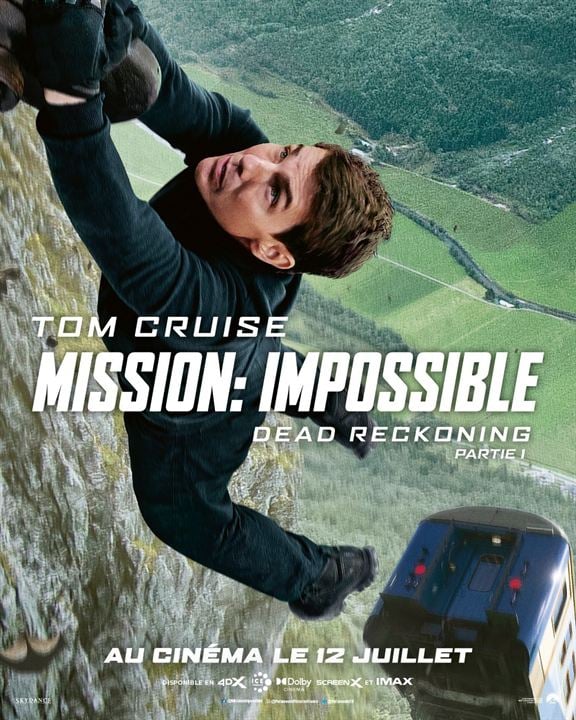 J’ai failli ne pas placer ce film dans mon top. Or hésiter n’était PAS prévu. Rogue Nation était dans mon top de 2015, Fallout, dans celui de 2017 : il n’y avait pas de raison que le duo Cruise/McQ se plante cette fois ! Et pourtant, ça a failli. Pour deux raisons, liées aux personnages féminins, assez mal gérés cette fois-ci [spoiler alert !]. D’abord, la mort de la sublime et charismatique, puisque jouée par Rebecca Ferguson, Ilsa Faust, personnage que McQ aura passé deux films et demi à développer… pour ÇA ? Une mort mal justifiée (le méchant impose au héros de choisir entre elle et… une nana qui sort de nulle part), mal préparée (le twist sort lui aussi de nulle part), exécutée sans conviction (Ilsa perd trop facilement contre un antagoniste anecdotique), et, pire du pire, trop vite oubliée car éclipsée par l’importance de la mission (duh) et par l’introduction de Grace/Hayley Atwell… nouvelle « M:I girl » de service qui est l’AUTRE raison de mon affliction, puisque l’actrice a beau assurer, son personnage de tête-à-claque n’en constitue pas moins un net déclassement. POUR AUTANT. On parle DU film de 2023 pour lequel j’ai été prêt à claquer 25 balles (!!!), en l’occurrence au luxueux Pathé Quai d’Ivry… et qui les a valus. Dead Reckoning a beau m’avoir déçu sous certains aspects, notamment un, assez prévisible, qui est la fameuse cascade à moto BIEN trop exploitée par la promo, il n’en reste pas moins un spectacle son et lumière qui calme souvent sa race, comme disait ma grande-tante. Surtout dans ses deux premiers tiers. La captivante séquence d’ouverture dans le sous-marin russe, à l’occasion de laquelle McQ réussit le tour de force de surprendre le public sur un terrain aussi balisé qu’un poste de commandement de submersible… l’atmosphérique première apparition d’Ethan Hunt, émergeant lentement des ténèbres sans accompagnement musical… l’attaque assez épique de la planque d’Ilsa sous une tempête de sable, où se rappellent à nos bons souvenirs les cuivres puissants de Lorne Balfe, qui livre ici un gargantuesque magnum opus aux intonations parfois bondiennes… le retour du délicieusement ambigu Kittridge, dont l’interprète Henry Czerny vole à peu près toutes ses scènes… le réjouissant épisode de l’aéroport de Dubai, qui m’a un peu rappelé la brillantissime scène de la gare de Waterloo dans The Bourne Ultimatum par la taille de son aire de jeu et son énergie… la réunion au sommet dans la boîte de nuit vénitienne, dix minutes d’état de grâce filmique, avec son festival de plans débullés depalmesques et de gros plans leoniens sur des visages tous plus charismatiques les uns que les autres (mention aux formidables cadrages du nouveau chef-op Fraser Taggart), où chaque mot compte, et qui m’a électrisé comme peu de scènes de ce parlote… l’explosif climax du train, bien sûr, qui m’a ravi d’avoir choisir l’IMAX… Rome étourdissante… Pom Klementieff… trop de choses. Le formidable Winter Break occupait initialement cette sixième place, mais le relatif échec commercial de Dead Reckoning m’impose ce geste militant, en dépit de mes réserves.
J’ai failli ne pas placer ce film dans mon top. Or hésiter n’était PAS prévu. Rogue Nation était dans mon top de 2015, Fallout, dans celui de 2017 : il n’y avait pas de raison que le duo Cruise/McQ se plante cette fois ! Et pourtant, ça a failli. Pour deux raisons, liées aux personnages féminins, assez mal gérés cette fois-ci [spoiler alert !]. D’abord, la mort de la sublime et charismatique, puisque jouée par Rebecca Ferguson, Ilsa Faust, personnage que McQ aura passé deux films et demi à développer… pour ÇA ? Une mort mal justifiée (le méchant impose au héros de choisir entre elle et… une nana qui sort de nulle part), mal préparée (le twist sort lui aussi de nulle part), exécutée sans conviction (Ilsa perd trop facilement contre un antagoniste anecdotique), et, pire du pire, trop vite oubliée car éclipsée par l’importance de la mission (duh) et par l’introduction de Grace/Hayley Atwell… nouvelle « M:I girl » de service qui est l’AUTRE raison de mon affliction, puisque l’actrice a beau assurer, son personnage de tête-à-claque n’en constitue pas moins un net déclassement. POUR AUTANT. On parle DU film de 2023 pour lequel j’ai été prêt à claquer 25 balles (!!!), en l’occurrence au luxueux Pathé Quai d’Ivry… et qui les a valus. Dead Reckoning a beau m’avoir déçu sous certains aspects, notamment un, assez prévisible, qui est la fameuse cascade à moto BIEN trop exploitée par la promo, il n’en reste pas moins un spectacle son et lumière qui calme souvent sa race, comme disait ma grande-tante. Surtout dans ses deux premiers tiers. La captivante séquence d’ouverture dans le sous-marin russe, à l’occasion de laquelle McQ réussit le tour de force de surprendre le public sur un terrain aussi balisé qu’un poste de commandement de submersible… l’atmosphérique première apparition d’Ethan Hunt, émergeant lentement des ténèbres sans accompagnement musical… l’attaque assez épique de la planque d’Ilsa sous une tempête de sable, où se rappellent à nos bons souvenirs les cuivres puissants de Lorne Balfe, qui livre ici un gargantuesque magnum opus aux intonations parfois bondiennes… le retour du délicieusement ambigu Kittridge, dont l’interprète Henry Czerny vole à peu près toutes ses scènes… le réjouissant épisode de l’aéroport de Dubai, qui m’a un peu rappelé la brillantissime scène de la gare de Waterloo dans The Bourne Ultimatum par la taille de son aire de jeu et son énergie… la réunion au sommet dans la boîte de nuit vénitienne, dix minutes d’état de grâce filmique, avec son festival de plans débullés depalmesques et de gros plans leoniens sur des visages tous plus charismatiques les uns que les autres (mention aux formidables cadrages du nouveau chef-op Fraser Taggart), où chaque mot compte, et qui m’a électrisé comme peu de scènes de ce parlote… l’explosif climax du train, bien sûr, qui m’a ravi d’avoir choisir l’IMAX… Rome étourdissante… Pom Klementieff… trop de choses. Le formidable Winter Break occupait initialement cette sixième place, mais le relatif échec commercial de Dead Reckoning m’impose ce geste militant, en dépit de mes réserves.




05. REALITY
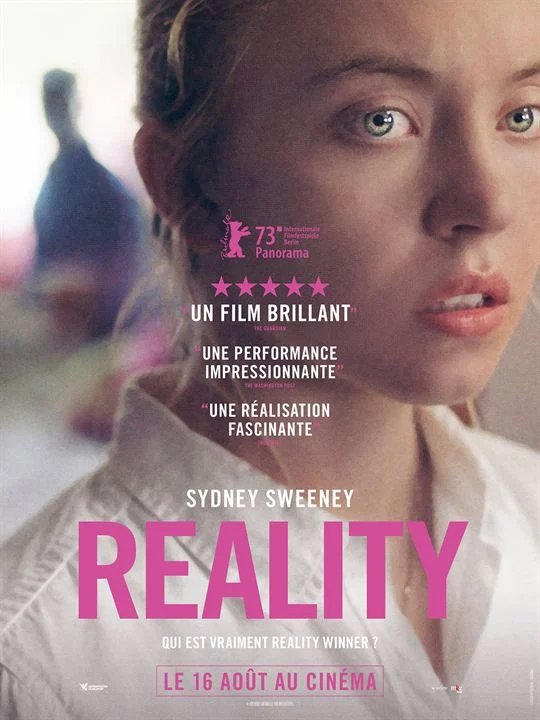 Salut les enfants, aujourd’hui, nous étudions LE POUVOIR DE LA MISE EN SCÈNE. Le cas d’école du jour : le thriller psychologique Reality, ou comment intégrer un top 10 annuel en 1h22 (à tout casser) quand les 3/4 de l’action de son film se limitent à trois personnages discutant poliment dans l’intimité glaçante d’une pièce nue. Non, sérieusement, la causerie est l’essentiel de l’action de ce huis clos qui reconstitue l’interrogatoire de Reality Winner, une ancienne employée de la NSA accusée d’espionnage en 2016… et vous savez quoi ? C’est captivant. Non pas parce que les dialogues sont brillants… mais parce qu’ils sont RÉELS : les transcriptions fidèles de l’interrogatoire tel qu’il a eu lieu. Idée sublime de simplicité, à tel point qu’on recommandera vivement au spectateur de visionner le film avec cette information à l’esprit, sans que ça ne « sorte » du film, au contraire, car alors, CHAQUE mot compte et renforce la véracité du récit. Sans ignorer l’étiquette « faits réels » ni le sujet hautement politique du film (la réalisatrice ne cache clairement pas son aversion ô combien originale pour Trump), il est indéniable que la tension propre à ce concept constitue l’intérêt premier de Reality, qui en tire d’ailleurs son atmosphère anxiogène. Le crime dont est coupable la pauvre Reality aurait pu être d’une TOUT AUTRE nature, et n’avoir aucune espèce de rapport avec l’Agent orange, l’essence du film aurait été la même, tant que l’appareil d’État se sent attaqué. À ce propos, Reality ne se contente pas de raconter une histoire vraie, il transcende son sujet pour devenir une étude universelle sur la peur, le pouvoir et la résistance, sous la forme d’un exercice de style unique et percutant. La mise en scène minimaliste de Tina Satter, dont l’approche accentue la sensation de claustrophobie et de tension croissante au fur et à mesure que l’histoire progresse vers l’inévitable arrestation, met en valeur la puissance des dialogues et des performances d’acteurs. Nous en venons alors au plat de résistance, la performance démentiellement nuancée de la fameuse bimbo d’Euphoria, Sydney Sweeney : vu le temps que Tina Satter a passé à cadrer chaque micro-expression de son visage, Sweeney devait absolument assurer, jusque dans les moindres micro-détails… et elle a. On parle, à mon sens, de quelque chose qui méritait l’honneur de la statuette suprême, mais bon, c’est vous qui voyez. Au passage, qualifier Reality de « film d’espionnage » est un peu tiré par les cheveux, mais avec l’actrice principale, la musique discrète mais diablement atmosphérique, et le crescendo dramatique des interactions avec les deux agents, eux aussi impeccablement joués, on peut sans hésitation le classer comme un thriller… redoutablement courtois.
Salut les enfants, aujourd’hui, nous étudions LE POUVOIR DE LA MISE EN SCÈNE. Le cas d’école du jour : le thriller psychologique Reality, ou comment intégrer un top 10 annuel en 1h22 (à tout casser) quand les 3/4 de l’action de son film se limitent à trois personnages discutant poliment dans l’intimité glaçante d’une pièce nue. Non, sérieusement, la causerie est l’essentiel de l’action de ce huis clos qui reconstitue l’interrogatoire de Reality Winner, une ancienne employée de la NSA accusée d’espionnage en 2016… et vous savez quoi ? C’est captivant. Non pas parce que les dialogues sont brillants… mais parce qu’ils sont RÉELS : les transcriptions fidèles de l’interrogatoire tel qu’il a eu lieu. Idée sublime de simplicité, à tel point qu’on recommandera vivement au spectateur de visionner le film avec cette information à l’esprit, sans que ça ne « sorte » du film, au contraire, car alors, CHAQUE mot compte et renforce la véracité du récit. Sans ignorer l’étiquette « faits réels » ni le sujet hautement politique du film (la réalisatrice ne cache clairement pas son aversion ô combien originale pour Trump), il est indéniable que la tension propre à ce concept constitue l’intérêt premier de Reality, qui en tire d’ailleurs son atmosphère anxiogène. Le crime dont est coupable la pauvre Reality aurait pu être d’une TOUT AUTRE nature, et n’avoir aucune espèce de rapport avec l’Agent orange, l’essence du film aurait été la même, tant que l’appareil d’État se sent attaqué. À ce propos, Reality ne se contente pas de raconter une histoire vraie, il transcende son sujet pour devenir une étude universelle sur la peur, le pouvoir et la résistance, sous la forme d’un exercice de style unique et percutant. La mise en scène minimaliste de Tina Satter, dont l’approche accentue la sensation de claustrophobie et de tension croissante au fur et à mesure que l’histoire progresse vers l’inévitable arrestation, met en valeur la puissance des dialogues et des performances d’acteurs. Nous en venons alors au plat de résistance, la performance démentiellement nuancée de la fameuse bimbo d’Euphoria, Sydney Sweeney : vu le temps que Tina Satter a passé à cadrer chaque micro-expression de son visage, Sweeney devait absolument assurer, jusque dans les moindres micro-détails… et elle a. On parle, à mon sens, de quelque chose qui méritait l’honneur de la statuette suprême, mais bon, c’est vous qui voyez. Au passage, qualifier Reality de « film d’espionnage » est un peu tiré par les cheveux, mais avec l’actrice principale, la musique discrète mais diablement atmosphérique, et le crescendo dramatique des interactions avec les deux agents, eux aussi impeccablement joués, on peut sans hésitation le classer comme un thriller… redoutablement courtois.




04. LA MONTAGNE
 La Montagne, ou le rappel que le cinéma français peut être parfaitement à l’aise dans le contemplatif. Ce deuxième film du trop rare Thomas Salvador a été un coup de cœur inattendu. Un coup de cœur pas vraiment partagé par grand monde non plus, vu sa moyenne « spectateurs » bien inférieure à sa moyenne « presse » sur Allociné. C’est compréhensible à certains égards, le film étant une immersion à infusion lente, plus à l’aise dans le silence (même la musique est TRÈS rare) que dans la frénésie moderne (ça m’a fait penser à Sylvain Tesson), borderline autiste comme son protagoniste murakamien… et en même temps, ce rejet étonne aussi un peu, car La Montagne est quand même sacrément beau à regarder, et sacrément immersif, avec son approche quasi-documentaire de l’alpinisme, alliant minimalisme et plans remplis à ras-bord, dont les premières bénéficiaires sont les majestueuses Alpes, parfaite toile de fond pour une expérience de quête de sens à la fois captivante… et reposante. Les jeux de lumière ajoutent une dimension presque mystique au décor, soulignant sa beauté brute, faisant de chaque lever et coucher du soleil un moment de pure poésie visuelle. L’approche physique et sensorielle du cinéma qui est celle de Salvador, en phase avec son rapport plein d’humilité et de révérence à la montagne, impose très vite le charme du film, bien aidé par les sublimes images du directeur de la photographie césarisé Alexis Kavyrchine. Ces dernières accompagnent avec une belle force évocatrice la méditation de Salvador sur la vie, la nature et la recherche de soi, chaque élément, des paysages aux interactions humaines, contribuant à faire partager au public l’odyssée intérieure du protagoniste. Les scènes de grimpe sont filmées avec un souci du détail qui fait ressentir l’improbable mélange d’adrénaline et de sérénité qui guide les alpinistes. Cette authenticité dans un cadre extraordinaire est ce qui permet au film de décoller, fort heureusement, BIEN AVANT l’apparition, à mi-métrage, des « lueurs », fascinantes visions minérales aux contours mythologiques par lesquelles il se distinguera fantastiquement du lot, dans une deuxième partie surnaturelle et hypnotique rappelant tantôt l’univers panthéiste de Miyazaki, tantôt un Abyss, euh, à l’envers. Le personnage incarné par la toujours ravissante Louise Bourgoin est l’autre grande réussite de cette seconde partie, car Salvador et sa coscénariste ont choisi de faire d’elle une figure d’amour pur, comme on l’observera dans sa réaction compassionnelle à la condition surnaturelle du protagoniste ; son idylle avec le protagoniste en ressort plus poignante et authentique que bien des idylles de cinéma où les personnages parlent BIEN plus entre eux, comme si le film l’étoffait naturellement en plaçant leur amour et les « lueurs » dans un même « tout », d’où mon évocation du panthéisme. PS : oh, en revanche, ce n’est pas parce que ton film a la nature pour cadre que ça en fait d’office une « fable écolo », merci.
La Montagne, ou le rappel que le cinéma français peut être parfaitement à l’aise dans le contemplatif. Ce deuxième film du trop rare Thomas Salvador a été un coup de cœur inattendu. Un coup de cœur pas vraiment partagé par grand monde non plus, vu sa moyenne « spectateurs » bien inférieure à sa moyenne « presse » sur Allociné. C’est compréhensible à certains égards, le film étant une immersion à infusion lente, plus à l’aise dans le silence (même la musique est TRÈS rare) que dans la frénésie moderne (ça m’a fait penser à Sylvain Tesson), borderline autiste comme son protagoniste murakamien… et en même temps, ce rejet étonne aussi un peu, car La Montagne est quand même sacrément beau à regarder, et sacrément immersif, avec son approche quasi-documentaire de l’alpinisme, alliant minimalisme et plans remplis à ras-bord, dont les premières bénéficiaires sont les majestueuses Alpes, parfaite toile de fond pour une expérience de quête de sens à la fois captivante… et reposante. Les jeux de lumière ajoutent une dimension presque mystique au décor, soulignant sa beauté brute, faisant de chaque lever et coucher du soleil un moment de pure poésie visuelle. L’approche physique et sensorielle du cinéma qui est celle de Salvador, en phase avec son rapport plein d’humilité et de révérence à la montagne, impose très vite le charme du film, bien aidé par les sublimes images du directeur de la photographie césarisé Alexis Kavyrchine. Ces dernières accompagnent avec une belle force évocatrice la méditation de Salvador sur la vie, la nature et la recherche de soi, chaque élément, des paysages aux interactions humaines, contribuant à faire partager au public l’odyssée intérieure du protagoniste. Les scènes de grimpe sont filmées avec un souci du détail qui fait ressentir l’improbable mélange d’adrénaline et de sérénité qui guide les alpinistes. Cette authenticité dans un cadre extraordinaire est ce qui permet au film de décoller, fort heureusement, BIEN AVANT l’apparition, à mi-métrage, des « lueurs », fascinantes visions minérales aux contours mythologiques par lesquelles il se distinguera fantastiquement du lot, dans une deuxième partie surnaturelle et hypnotique rappelant tantôt l’univers panthéiste de Miyazaki, tantôt un Abyss, euh, à l’envers. Le personnage incarné par la toujours ravissante Louise Bourgoin est l’autre grande réussite de cette seconde partie, car Salvador et sa coscénariste ont choisi de faire d’elle une figure d’amour pur, comme on l’observera dans sa réaction compassionnelle à la condition surnaturelle du protagoniste ; son idylle avec le protagoniste en ressort plus poignante et authentique que bien des idylles de cinéma où les personnages parlent BIEN plus entre eux, comme si le film l’étoffait naturellement en plaçant leur amour et les « lueurs » dans un même « tout », d’où mon évocation du panthéisme. PS : oh, en revanche, ce n’est pas parce que ton film a la nature pour cadre que ça en fait d’office une « fable écolo », merci.




03. AFTERSUN
 Allez, avec ce petit chef-d’oeuvre l’air de rien, on entre dans le trio de tête de 2023, triumvirat qui sera resté inchangé neuf mois durant, mine de rien. Une inoubliable expérience… qui n’en parait pas une, de loin, non, on s’attend tout au plus à une agréable tranche de vie contée sur le ton de la comédie dramatique douce-amère… mais qui le devient, progressivement, pour finir en immense film sur la dépression, une dépression qui ne se dit pas, évidemment, comme tant, vue à travers les yeux les plus innocents. Un film où rien de bien dramatique ne se passe à l’écran, 99% du temps, pensez bien, une compilation de vidéos de vacances entre un père et sa petite fille, et où pourtant le tragique menace constamment de poindre, au détour du moindre sourire, du câlin le plus trivial. La solidité dramaturgique d’Aftersun est remarquable. Tout d’abord, il remue avec un des plus beaux personnages de père que j’ai vus au cinéma, de récente mémoire, ne serait-ce que parce qu’on voit à la fois le père ET l’homme… le père du point de vue de sa fille, responsable et aimant, donnant confiance en un avenir auquel on ignore tout… et l’homme dans l’intimité, c’est-à-dire TOUT ce qu’il n’a PAS le droit d’être en présence de sa petite fille, POUR sa petite fille. Et parfois, les deux apparaissent en même temps, et là, ça fait mal, d’autant plus qu’Aftersun est aussi la découverte d’une môme sensationnelle, l’adorable Frankie Corio, qui profite, dès les premières minutes, de sa toute aussi sensationnelle alchimie avec Paul Mescal – là aussi, un des plus beaux portraits père-fille vus depuis un bail – kind of magic que l’on doit avant tout à la réalisatrice Charlotte Wells. Parlons d’elle : sa caméra est SI forte, et son écriture SI juste, et accompagnée d’un montage plein de fulgurances (le fondu du père faisant face à la foule qui chante son anniversaire au père pleurant, de dos), que le plus simple plan de ces deux-là peut susciter le plus grand émoi en une économie de moyens. Au rayon substance, Aftersun est une belle réflexion sur la subjectivité du souvenir, ainsi que sur l’inévitabilité de cette subjectivité, qui s’exprime notamment à travers la tension sans cesse renouvelée entre les enregistrement (la réalité) et les souvenirs de la protagoniste adulte. Le superbe travail de montage a embrassé cette subjectivité pour immerger le spectateur dans un état de transe, balloté par le tumulte de la mémoire : on est souvent dans la tête de Sophie, dans le vif de ses souvenirs. Aftersun, film indé qui n’a pas volé ses échos critiques pour changer, est le genre de film tellement bon que je l’aurais souhaité PARFAIT, pour n’avoir AUCUNE critique à émettre. Parce qu’il y en a. Je pense aux deux scènes de Sophie à l’âge adulte, jouée par une actrice un peu chelou, quoique même elle s’en sort plutôt bien dans les brefs passages oniriques qui traversent le film, jusqu’au fameux, SIDÉRANT climax sur Under Pressure remixé à la sauce dépressive, tube à jamais associé à ce film, en ce qui me concerne (« this is our last dance »… wow). Et puis, quand on revient à Paul Mescal et Frankie Corio ensemble, à la fois heureux et plus que ça, à la fois heureux et moins que ça, ce vague grief est vite balayé.
Allez, avec ce petit chef-d’oeuvre l’air de rien, on entre dans le trio de tête de 2023, triumvirat qui sera resté inchangé neuf mois durant, mine de rien. Une inoubliable expérience… qui n’en parait pas une, de loin, non, on s’attend tout au plus à une agréable tranche de vie contée sur le ton de la comédie dramatique douce-amère… mais qui le devient, progressivement, pour finir en immense film sur la dépression, une dépression qui ne se dit pas, évidemment, comme tant, vue à travers les yeux les plus innocents. Un film où rien de bien dramatique ne se passe à l’écran, 99% du temps, pensez bien, une compilation de vidéos de vacances entre un père et sa petite fille, et où pourtant le tragique menace constamment de poindre, au détour du moindre sourire, du câlin le plus trivial. La solidité dramaturgique d’Aftersun est remarquable. Tout d’abord, il remue avec un des plus beaux personnages de père que j’ai vus au cinéma, de récente mémoire, ne serait-ce que parce qu’on voit à la fois le père ET l’homme… le père du point de vue de sa fille, responsable et aimant, donnant confiance en un avenir auquel on ignore tout… et l’homme dans l’intimité, c’est-à-dire TOUT ce qu’il n’a PAS le droit d’être en présence de sa petite fille, POUR sa petite fille. Et parfois, les deux apparaissent en même temps, et là, ça fait mal, d’autant plus qu’Aftersun est aussi la découverte d’une môme sensationnelle, l’adorable Frankie Corio, qui profite, dès les premières minutes, de sa toute aussi sensationnelle alchimie avec Paul Mescal – là aussi, un des plus beaux portraits père-fille vus depuis un bail – kind of magic que l’on doit avant tout à la réalisatrice Charlotte Wells. Parlons d’elle : sa caméra est SI forte, et son écriture SI juste, et accompagnée d’un montage plein de fulgurances (le fondu du père faisant face à la foule qui chante son anniversaire au père pleurant, de dos), que le plus simple plan de ces deux-là peut susciter le plus grand émoi en une économie de moyens. Au rayon substance, Aftersun est une belle réflexion sur la subjectivité du souvenir, ainsi que sur l’inévitabilité de cette subjectivité, qui s’exprime notamment à travers la tension sans cesse renouvelée entre les enregistrement (la réalité) et les souvenirs de la protagoniste adulte. Le superbe travail de montage a embrassé cette subjectivité pour immerger le spectateur dans un état de transe, balloté par le tumulte de la mémoire : on est souvent dans la tête de Sophie, dans le vif de ses souvenirs. Aftersun, film indé qui n’a pas volé ses échos critiques pour changer, est le genre de film tellement bon que je l’aurais souhaité PARFAIT, pour n’avoir AUCUNE critique à émettre. Parce qu’il y en a. Je pense aux deux scènes de Sophie à l’âge adulte, jouée par une actrice un peu chelou, quoique même elle s’en sort plutôt bien dans les brefs passages oniriques qui traversent le film, jusqu’au fameux, SIDÉRANT climax sur Under Pressure remixé à la sauce dépressive, tube à jamais associé à ce film, en ce qui me concerne (« this is our last dance »… wow). Et puis, quand on revient à Paul Mescal et Frankie Corio ensemble, à la fois heureux et plus que ça, à la fois heureux et moins que ça, ce vague grief est vite balayé.




02. BABYLON
 Parce que le cinéma est avant tout conçu pour faire ressentir, le très clivant Babylon a beau avoir ses couacs, et le terme de chef-d’œuvre être galvaudé, rien à cirer : chef-d’œuvre. Autant j’ai été très impressionné par Whiplash, introduction de bruit et de fureur au cinéma de Damian Chazelle, autant j’ai trouvé La La Land un peu artificiel – charmant, par endroits virtuose, mais un peu artificiel – et First Man émotionnellement indisponible, aussi peut-on dire que je ne suis pas entré dans Babylon en fanboy. Autant dire qu’il a remis les compteurs à zéro, en me renversant comme PEU de films l’ont fait, ces dernières années, foisonnant, exaltant, doté d’une première heure qui m’a inspiré à plusieurs reprises la remarque suivante, alors que passaient ses grandioses minutes, « c’est un des meilleurs putains de trucs que j’ai vus de ma vie » : techniquement impressionnante – mais ça, on pouvait s’y attendre –, sublimée par un magnifique utilisation du 35mm et du cinémascope, emballée par l’irrésistible musique de Justin Hurwitz, qui fait de la scène de la soirée un classique du cinéma avec ses orchestrations grandioses, son rythme effréné et ses tourbillonnements jazzys… et assez souvent hilarante. Puis après, ça devient plus sérieux. Rien de plus logique : après tout, Babylon n’est rien de moins qu’un monument érigé à la fin d’un monde. Une fin dont la dimension tragique, négligée, prend parfois par surprise, notamment à travers le personnage de star du muet qu’interprète avec une grande finesse Brad Pitt, et à travers le destin tragique de celui qu’interprète Margot Robbie. Certains critiquent le basculement dans le thriller cauchemardesque qu’opère le film dans son troisième acte, avec un Tobey Maguire glauquissime, mais cette exubérante partie est, au contraire, l’étape finale de la chute de la Babylone des années 1920. La fin de partie n’a pas été sifflée ; cette dernière a juste été déménagé dans la marge par le Hollywood puritain des années 30. Et il fallait la voir, cette marge. Non, vraiment, exceptionnel, comme 99% de ce qu’a fait Chazelle sur ce film, notamment dans sa façon d’aborder les thèmes de la décadence et du changement d’ère, ou encore de gérer les contrastes entre les moments de pure euphorie et ceux d’intense désespoir. C’est de l’artisanat cinq étoiles. Chaque scène est conçue avec une précision qui confère à l’ensemble une dynamique vertigineuse, et l’intensité narrative plonge dans un tourbillon d’émotions qui rappelle le pouvoir de transcendance du septième art. Babylon n’est pas « juste » une fresque à l’ancienne, c’est une expérience à vivre intensément, et ce niveau d’exigence explique le rejet dont il a été l’objet. Je ne pourrai cependant conclure sans aborder la question de l’ABERRANT épilogue méta, monument d’incohérence stylistique minant la continuité narrative du film, et à cause duquel Babylon n’est finalement PAS au sommet de ce top : peu importent les intentions de Chazelle, tout ce que son délire accomplit, c’est SORTIR complètement le spectateur de son film.
Parce que le cinéma est avant tout conçu pour faire ressentir, le très clivant Babylon a beau avoir ses couacs, et le terme de chef-d’œuvre être galvaudé, rien à cirer : chef-d’œuvre. Autant j’ai été très impressionné par Whiplash, introduction de bruit et de fureur au cinéma de Damian Chazelle, autant j’ai trouvé La La Land un peu artificiel – charmant, par endroits virtuose, mais un peu artificiel – et First Man émotionnellement indisponible, aussi peut-on dire que je ne suis pas entré dans Babylon en fanboy. Autant dire qu’il a remis les compteurs à zéro, en me renversant comme PEU de films l’ont fait, ces dernières années, foisonnant, exaltant, doté d’une première heure qui m’a inspiré à plusieurs reprises la remarque suivante, alors que passaient ses grandioses minutes, « c’est un des meilleurs putains de trucs que j’ai vus de ma vie » : techniquement impressionnante – mais ça, on pouvait s’y attendre –, sublimée par un magnifique utilisation du 35mm et du cinémascope, emballée par l’irrésistible musique de Justin Hurwitz, qui fait de la scène de la soirée un classique du cinéma avec ses orchestrations grandioses, son rythme effréné et ses tourbillonnements jazzys… et assez souvent hilarante. Puis après, ça devient plus sérieux. Rien de plus logique : après tout, Babylon n’est rien de moins qu’un monument érigé à la fin d’un monde. Une fin dont la dimension tragique, négligée, prend parfois par surprise, notamment à travers le personnage de star du muet qu’interprète avec une grande finesse Brad Pitt, et à travers le destin tragique de celui qu’interprète Margot Robbie. Certains critiquent le basculement dans le thriller cauchemardesque qu’opère le film dans son troisième acte, avec un Tobey Maguire glauquissime, mais cette exubérante partie est, au contraire, l’étape finale de la chute de la Babylone des années 1920. La fin de partie n’a pas été sifflée ; cette dernière a juste été déménagé dans la marge par le Hollywood puritain des années 30. Et il fallait la voir, cette marge. Non, vraiment, exceptionnel, comme 99% de ce qu’a fait Chazelle sur ce film, notamment dans sa façon d’aborder les thèmes de la décadence et du changement d’ère, ou encore de gérer les contrastes entre les moments de pure euphorie et ceux d’intense désespoir. C’est de l’artisanat cinq étoiles. Chaque scène est conçue avec une précision qui confère à l’ensemble une dynamique vertigineuse, et l’intensité narrative plonge dans un tourbillon d’émotions qui rappelle le pouvoir de transcendance du septième art. Babylon n’est pas « juste » une fresque à l’ancienne, c’est une expérience à vivre intensément, et ce niveau d’exigence explique le rejet dont il a été l’objet. Je ne pourrai cependant conclure sans aborder la question de l’ABERRANT épilogue méta, monument d’incohérence stylistique minant la continuité narrative du film, et à cause duquel Babylon n’est finalement PAS au sommet de ce top : peu importent les intentions de Chazelle, tout ce que son délire accomplit, c’est SORTIR complètement le spectateur de son film.




01. THE QUIET GIRL
 Voici donc le premier – et, accessoirement, le deuxième film du peloton de tête à avoir une petite brune pour révélation. Qui l’aurait cru ? Les chefs-d’oeuvre aux dehors discrets sont une expérience rare et précieuse. La tarte qu’ils vous envoient vient de nulle part, on est d’autant plus sonné qu’impréparé. The Quiet Girl en est une, de tarte. Une à la fois douce et vivace, si c’est possible. Une assez compliquée logistiquement, aussi, car, mû par le plus toxique des virilismes, j’ai dû lutter contre les larmes pendant une BONNE HEURE pour ne pas pas passer pour la chiffe molle de service auprès de mes camarades, moi dont la précédente poussée lacrymale dans une salle obscure remontait à des années, plus précisément 2016, avec l’autrement plus tragique Manchester by The Sea. Donc, une bonne heure, pas juste la fin, car contrairement à la plupart des films qui m’ont émotionné par le passé, The Quiet Girl m’a pris à la gorge… à peine passé le premier quart d’heure. Et je n’ai pas tout de suite compris comment. Le film porte bien son titre : sa petite héroïne EST discrète, du moins le plus souvent possible, tout comme l’est la répression de ses émotions, qu’on distingue de temps à autres dans ses beaux yeux tristes… ses interactions avec le couple de quinquagénaires marqué par une tragédie SONT, elles aussi, discrètes… même la photographie, pourtant magnifique, a quelque chose de discret. Et pourtant, l’empreinte que le film a laissée sur mon âme est TOUT, sauf discrète, car TOUT ce qu’il est sert brillamment, avec un dévouement et une empathie rares, un seul et même objectif : saisir à la volée filmique la bouleversante éclosion d’une petite fille qui n’avait besoin que d’un brin d’amour dans une discrète harmonie en phase avec son caractère. Le film étant avare en mots, l’essentiel passe par le jeu de la jeune Catherine Flinch, dont les sentiments passent par les plus subtiles expressions et le visage devient vite un tableau, et par le travail de Kate McCullough (une femme chef op, yay !), qui a eu l’imposante tâche de l’épauler avec la même hypersensibilité, revenant presque aux origines muettes du cinéma… raison pour laquelle le film m’a ému si tôt. Le choix qu’elle et le réalisateur à suivre Colm Bairéad ont fait du format carré paie, par ailleurs, pour changer : le cadre est la limitation du champ de vision de la pauvre gamine, qui n’attend qu’à s’ouvrir au monde, et elle en sortira même partiellement, lors de ses scènes de course. Toute la forme, d’un puissant minimalisme et d’une poésie pleine de dignité, accompagne ainsi avec une incroyable aisance cette histoire d’éclosion qui rappelle avec justesse ce que doit être un père (ça dit des choses très vraies sur l’expression masculine de l’affection), et ce que doit être une mère. Et la fin, dont les violons doux de Stephen Rennicks décuplent la charge émotionnelle, n’a cependant rien de pessimiste : oui, sa tête de con de père biologique vient la chercher, mais ce n’est pas lui qu’elle appelle « daddy » ; son horizon s’est ouvert, rien ne défera ce qui a été fait le temps de ce tendre été. La grâce est absolue (en plus d’être discrète), et la nomination aux Oscars, méritée.
Voici donc le premier – et, accessoirement, le deuxième film du peloton de tête à avoir une petite brune pour révélation. Qui l’aurait cru ? Les chefs-d’oeuvre aux dehors discrets sont une expérience rare et précieuse. La tarte qu’ils vous envoient vient de nulle part, on est d’autant plus sonné qu’impréparé. The Quiet Girl en est une, de tarte. Une à la fois douce et vivace, si c’est possible. Une assez compliquée logistiquement, aussi, car, mû par le plus toxique des virilismes, j’ai dû lutter contre les larmes pendant une BONNE HEURE pour ne pas pas passer pour la chiffe molle de service auprès de mes camarades, moi dont la précédente poussée lacrymale dans une salle obscure remontait à des années, plus précisément 2016, avec l’autrement plus tragique Manchester by The Sea. Donc, une bonne heure, pas juste la fin, car contrairement à la plupart des films qui m’ont émotionné par le passé, The Quiet Girl m’a pris à la gorge… à peine passé le premier quart d’heure. Et je n’ai pas tout de suite compris comment. Le film porte bien son titre : sa petite héroïne EST discrète, du moins le plus souvent possible, tout comme l’est la répression de ses émotions, qu’on distingue de temps à autres dans ses beaux yeux tristes… ses interactions avec le couple de quinquagénaires marqué par une tragédie SONT, elles aussi, discrètes… même la photographie, pourtant magnifique, a quelque chose de discret. Et pourtant, l’empreinte que le film a laissée sur mon âme est TOUT, sauf discrète, car TOUT ce qu’il est sert brillamment, avec un dévouement et une empathie rares, un seul et même objectif : saisir à la volée filmique la bouleversante éclosion d’une petite fille qui n’avait besoin que d’un brin d’amour dans une discrète harmonie en phase avec son caractère. Le film étant avare en mots, l’essentiel passe par le jeu de la jeune Catherine Flinch, dont les sentiments passent par les plus subtiles expressions et le visage devient vite un tableau, et par le travail de Kate McCullough (une femme chef op, yay !), qui a eu l’imposante tâche de l’épauler avec la même hypersensibilité, revenant presque aux origines muettes du cinéma… raison pour laquelle le film m’a ému si tôt. Le choix qu’elle et le réalisateur à suivre Colm Bairéad ont fait du format carré paie, par ailleurs, pour changer : le cadre est la limitation du champ de vision de la pauvre gamine, qui n’attend qu’à s’ouvrir au monde, et elle en sortira même partiellement, lors de ses scènes de course. Toute la forme, d’un puissant minimalisme et d’une poésie pleine de dignité, accompagne ainsi avec une incroyable aisance cette histoire d’éclosion qui rappelle avec justesse ce que doit être un père (ça dit des choses très vraies sur l’expression masculine de l’affection), et ce que doit être une mère. Et la fin, dont les violons doux de Stephen Rennicks décuplent la charge émotionnelle, n’a cependant rien de pessimiste : oui, sa tête de con de père biologique vient la chercher, mais ce n’est pas lui qu’elle appelle « daddy » ; son horizon s’est ouvert, rien ne défera ce qui a été fait le temps de ce tendre été. La grâce est absolue (en plus d’être discrète), et la nomination aux Oscars, méritée.


Mentions (15 films)
Remarque : six des quinze films suivants sont français.
– Le Procès Goldman : grand film français. La reproduction SAISISSANTE de l’esthétique des années 70 (là aussi !), du grain de l’image aux accoutrements en passant par le parler, même, donne l’impression que Gianmaria Volonte peut débarquer à n’importe quel moment. Bien que son action se déroule essentiellement dans un tribunal, et sans musique, il se dégage une énergie folle de la mise en scène dénuée d’artifices narratifs de l’inégal (lui aussi !) Cédric Kahn, qui fait la part belle aux acteurs (Arthur Harari, ou le « MVP » du film). Quoiqu’il offre une réflexion vaguement intéressante sur la justice et les biais personnels, c’est par son refus de trancher que brille essentiellement son scénario.
– Winter Break (voir ci-dessous) : je n’ai jamais été fan du cinéma d’Alexander Payne (L’Arriviste, brrrr), à l’exception notable de Sideways… que ce Holdovers (ignorons le titre « français » débile) m’a rappelé avec un beau panache (la présence de Paul Giamatti a aidé). Il n’invente rien, mais se distingue du lot amerloque par ses dialogues brillants, ses performances authentiques, à commencer par celle du nouveau venu Dominic Sessa (!!!), par son exquise reconstitution désaturée des années 70, par son atmosphère douce-amère… et par son étonnante positivité, le dernier acte suggérant, grosso modo, qu’il suffit de connaître quelqu’un pour l’apprécier. J’ai beau trouver tarte l’expression « film de Noël »… c’en est un mémorable.

– Sur la branche : parce que si je n’en parle pas, personne d’autre ne le fera, là, en revanche. C’est un petit film, très mineur, dont l’intrigue criminelle ne décolle jamais vraiment, et qui aurait grandement profité d’un bon quart d’heure supplémentaire, notamment au rayon du développement des personnages… et pourtant, ça a été un coup de cœur instantané, grâce au duo vraiment irrésistible formé par Mimi (topissime Daphné Patakia) et l’avocat acariâtre Paul (Benoit Poelvoorde au poil). La dynamique de leur binôme est l’âme du film, la réalisatrice Marie Garel-Weiss en ayant fait un vecteur d’humour ET une très touchante histoire d’amitié. Une échappée belle dont le charme excentrique me rappelle un peu Victoria.
– Past Lives (voir ci-dessous) : TRÈS beau portrait de femme, incroyablement authentique, au romantisme assez unique, s’interdisant le mélo miaulant et les conflits artificiels, doublé d’une très pertinente réflexion sur l’influence des choix qu’on fait sur son identité ET sur la beauté douce-amère des « et si…? ». Cette dernière scène, ce silence en attendant l’Uber : inoubliable. [Spoiler alert !] On y voit une vie mourir pour laisser sa place à une autre, chacun de nos choix scellant le sort d’existences entières qu’on ne connaîtra jamais. Past Lives, c’est Nora, touchante protagoniste aux tourments universels, comprenant ça dans le cadre de sa vie amoureuse, et c’est d’une limpidité définitive. Seul bémol : le personnage d’Arthur, un peu trop mâle bêta. Mais buzz mérité.

Ainsi que : How to Have Sex (portrait terrifiant de tristesse de la génération Z, porté par la fascinante lutte intérieure de sa protagoniste brillamment interprétée… et mention au fait que le film ne nous bassine pas avec la « toxicité masculine », sa tragédie est le fait des DEUX sexes), Fermer les yeux (un film d’une longueur et d’une lenteur exigeantes, mais qui fait ressentir, à propos du temps qui passe, du passé, et de sa propre identité, des émotions rares), Je verrai toujours vos visages (un drame intense, aux sérieux airs de documentaire, fascinant par son propos, social dans ce que ça a de plus noble, et brillamment interprété, à commencer par la Exarchopoulos, dont j’aurais juste aimé que la cinéaste confronte nos victimes à des VRAIES ordures !), Les Colons (un film à ce point ensorcelant esthétiquement que si son intrigue, très brouillonne, avait été autant chiadée que sa photographie, il aurait intégré illico le top 10), The Whale (même quand Aronofsky foire en partie son coup, avec son goût pour le mélodrame, il te marque à vie, ici en deux temps, la scène de Samantha Morton et le GLORIEUX twist de fin), Dernière nuit à Milan (ne serait-ce que pour l’impressionnant générique d’intro, tour de force technique qui en fait un des plus canons de l’histoire du cinéma… mais ne vous inquiétez pas, Pierfrancesco Favino assure, le reste du temps !), Le Règne animal (le film a beau ne pas m’avoir convaincu dans le fond, maigre et naïf, Cailley y montre tout son vaste talent de créateur d’espaces cinématographiques et d’atmosphères, et l’ado est génial), Misanthrope (solide petit thriller aux quelques faiblesses scénaristiques transcendées par la mise en scène frontale, qui plonge dans une traque sans temps mort à hauteur de femme, pleine de rebondissements malins, couplée d’un propos désabusé sur les mécanismes politiques de la traque, et portée par un duo d’acteurs remarquable), Farang (giga-coup de tatane cinéphilique : le film a certes par endroits comme un parfum rétro de film avec JCVD, mais quand il débaroule sauvagement des tronches, on est plus proche de The Raid… qui savait Xavier Gens capable de ÇA ?!), Omar la fraise (autre formidable petite surprise, délicieusement inclassable, pleine d’énergie et d’humanité, mise en scène avec du caractère, et menée par un pétaradant duo d’anciens malfrats à la ramasse joués par deux acteurs qui font le show), et, enfin, Godzilla Minus One (un 37ème opus remarquablement ficelé, bien supérieur à la branlette Shin Godzilla, et que j’aurais volontiers placé dans mon top, ne serait-ce que pour son SPECTACULAIRE accomplissement en matière d’effets spéciaux, si l’acteur principal n’avait pas le charisme d’un sandwich thon-mayonnaise…).
Au rayon « films que j’aurais aimé adorer » (10 films)
Ceci n’est PAS un « flop », juste un échantillon de films que j’ai trouvés dignes d’intérêt, mais dont je ne partage pas l’adulation de la presse. Faites-moi un procès.
– The Fabelmans (voir ci-dessous) (moyenne presse selon Allociné : 4,9/5 !) : Spielberg a passé les quinze dernières années à me décevoir souvent, avec son cinéma-musée Grévin. Avec ce film-ci, ça bouge un peu… mais ça reste plan-plan. C’est un joli film… qui ne bouscule RIEN, surtout pas ceux connaissant déjà la bio du cinéaste, et qui sert surtout à conforter les cinéphiles. La première moitié est sympatoche, avec quelques moments épatants consacrés à l’artisanat de Spielberg, mais c’est sous-traité. Le drame familial fonctionne grâce aux acteurs, malgré la tronche de poupée en silicone de Michelle Williams. Mais ça se dégrade dans la seconde moitié, festival de clichés ressemblant plus à une série Netflix. L’épilogue avec Lynch/John Ford est fort, mais couronne un film trop mou. Presque le Armageddon Times de 2023.
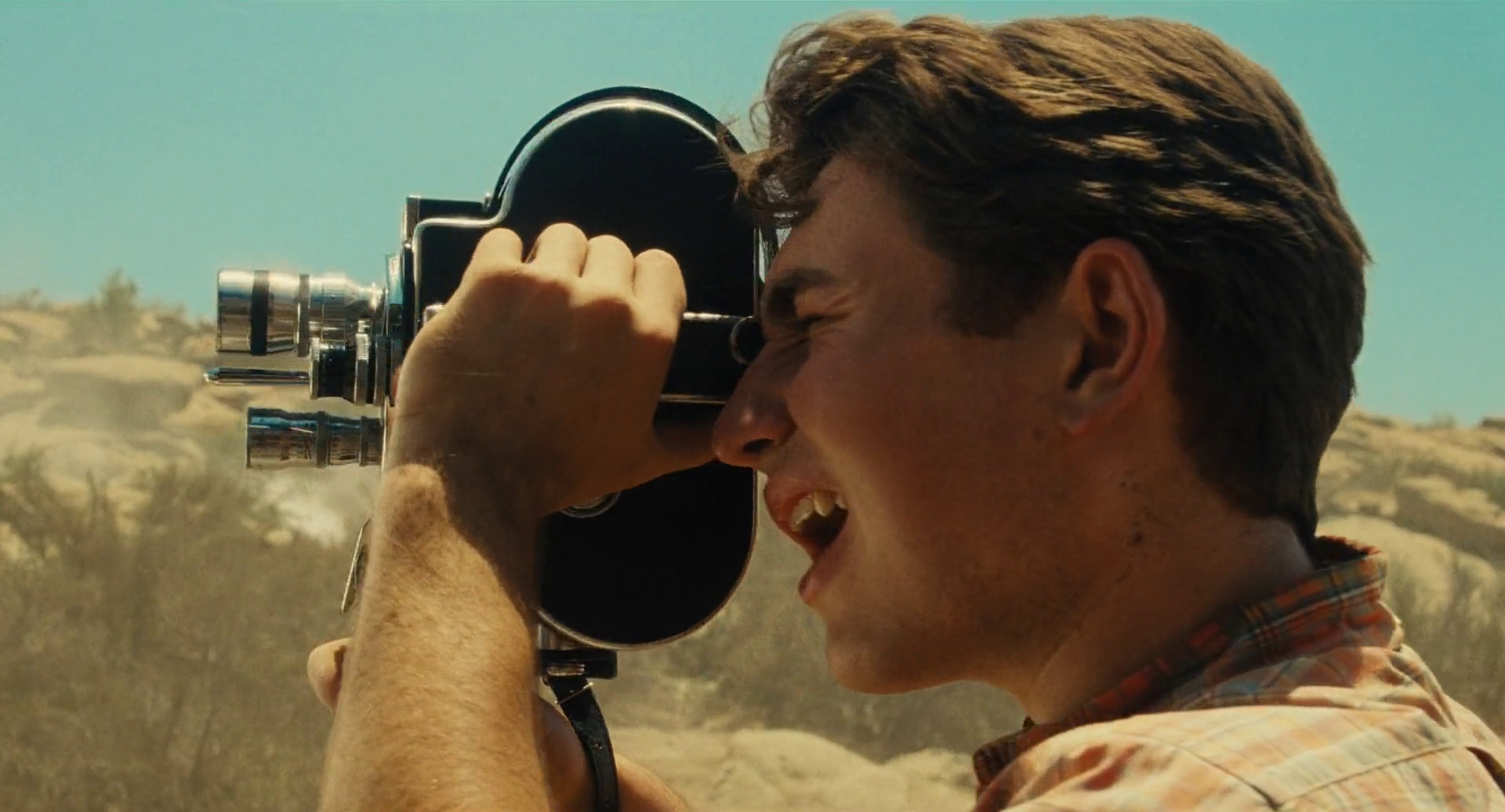
– Anatomie d’une chute (4,4/5) : alors, c’était bien… c’était même TRÈS bien, par endroits, de la performance impérialement ambiguë de Sandra Hüller au twist de fin, qu’on voit un peu venir mais qui n’en est pas moins joliment amené, en passant par le gamin qui joue le fils, et SA scène de tribunal, grand moment du 3ème acte… mais de là à crier au chef-d’oeuvre ? Pour un drame judiciaire, les scènes de procès d’Anatomie manquent singulièrement de panache, Swann Arlaud y est cruellement sous-employé… et surtout, l’insupportable personnage du mari chouineur, caricature surlignant le manichéisme du féminisme de Triet et Harari, c’est juste pas possible.
– Killers of the Flower Moon (4,4/5) : et un autre irritant exemple de surclassement cinéphilique de 2023, un ! Ses imbitables 3h30 ne sont absolument PAS justifiées, ni par l’intrigue, ni par la dramaturgie, ni par la… euh, qualité. Il n’est peut-être pas MAUVAIS (belle photographie, belle reconstitution, belles performances, quoiqu’ils en font trop avec Lily Gladstone…), mais il est TOUT sauf majeur. Que ses défenseurs me citent UNE scène marquante ! Le problème ? Entre Leo passant son temps à jouer un abruti fini le menton en avant, papy Scorsese choisissant la voie bien rasoir du cynisme désabusé, et la musique totalement inappropriée, je n’ai eu rien à foutre de ce que je regardais, peu importe la force du propos. Pas glop.
– Spider-Man: Across the Spider-Verse (4,1/5) : après un premier opus visuellement pétaradant MAIS scénaristiquement pas folichon et sanctifié pour des raisons idéologiques (vive la diversité), revoici le Spider-Verse dans une aventure artisanalement renversante et artistiquement inspirée, surtout dans son premier acte et sa toute fin… mais scénaristiquement TRÈS inégale, avec une désacralisation de la figure du superhéros qui me gênait déjà avant, et un second acte narrativement bordélique, dont le gloubi-boulga visuel a failli me faire syncoper à mi-métrage, avec sa pagaille bariolée de personnages et sa pagaille bariolée de dimensions. D’autant plus que les enjeux dramatiques sont nuls. Mais bon, la « gen Z » adore…
– Maestro (3,9/5) : Plusieurs personnages secondaires : « Maître Bernstein a fait ceciiiii de sensssssationnel et a fait celaaaa d’historiiiiiique, qu’il est graaaaand, toussatoussa. » Le public : « Mmmmh ok, on peut en voir un bout ? » Le film : « Euh, ouais, si vous voulez, voilà cinq minutes, mais pas plus, hein, parce qu’on est là pour parler de la bisexualité du gars, merci. » (hum) Adorant A Star is Born et ayant vibré devant la splendide bande-annonce, j’étais prêt à ADORER Maestro… mais pas cette esbrouffe pour Oscars. L’interprétation, la photographie, le travail de reconstitution et de maquillage (!) peuvent être brillants, ils ne masquent pas le fait que Cooper n’avait pas grand-chose à dire d’intéressant.
– Oppenheimer (voir ci-dessous) (3,8/5) : la scène de l’essai nucléaire est sensationnelle. Le crescendo dramatique de ouf qui y mène, le sound design brilliantissime, l’utilisation intelligente de la musique et du silence, le chuchotement de LA réplique historique, le feu embrasant l’air, le souffle suivi du son… c’est du Nolan. Mais ça, ça arrive au bout de près de deux heures. Et après, il reste près d’une heure. De quoi ? De beaucoup de blabla pas particulièrement bien dialogué, récité par des encravatés secondaires interchangeables, où sautent aux yeux l’écueil numéro 1 du cinéaste, l’écriture de personnages. Comme celui d’RJD, qui devient soudain le Salieri de son Mozart pour le 3ème acte. Bof.

– Yannick (3,8/5) : à mettre dans le lot des Dupieux « ok », mais aussi des succès populaires surestimés. Quenard crève l’écran en grand escogriffe déprimé par notre époque, la parodie de mauvaise comédie de boulevard fait parfois mouche, AINSI que Pio Marmaï, pour changer, mais le film a une franche limite, celle du Yannick en question : pour incarner le spectateur moyen et Français périphérique, Dupieux a choisi un personnage UN PEU trop antipathique, et illettré, et intellectuellement limité, au point d’en devenir insultant. Zéro syndrome de Stockholm, avec Yannick, le gars est relou. L’antiélitisme, d’accord, mais si c’est exprimé de façon pertinente, or là, ça tourne un peu à vide. Comme d’hab, Dupieux a bâclé le travail.
– Chien de la casse (3,7/5) : Mouais. Ce film au titre assez génial a pour lui son atmosphère archi-authentique, un Quenard BRILLANT en gros relou, et sa tâche admirable de dépeindre une amitié toxique sans ménager son public… mais justement, le film a beau durer 1h30, on en sent malgré tout passer une BONNE partie, à cause des diverses scènes d’humiliation que Mirales fait subir à Dog, et qui rappellent combien susciter le malaise chez le spectateur est risqué. Le tout a intérêt à être bien dosé. Or l’amitié du film a un gros problème de dosage, avec son ami #1 méga-kéké et son ami #2 hyper-zombie, sorte de NON-personnage, dont on peine un peu à comprendre pourquoi ils se fréquentent.
– Beau is Afraid (3,6/5) : après la douche froide Midsommar, je m’attendais à une catastrophe déboulonnant Ari Aster… mais si c’est à la fois confus et confusionnant, le naufrage est évité. Joaquin Phoenix est brillant, sans surprise, et le film réussit à retranscrire l’expérience du constant état d’angoisse et d’anxiété, aux frontières de la folie, de façon viscérale et parfois vertigineuse, embrassant le chaos freudien du protagoniste… enfin, ça, c’est quand ça marche. Et comme Aster a la grosse tête, il y a PLEIN de fois où ça se rétame, comme, par exemple, dans la dernière demi-heure, qui est à jeter au feu. Et trois heures, c’est long. Je préfère les OVNI quand ils sont TOTALEMENT réussis, comme le sublime Mother! d’Aronofsky…
– John Wick – Chapitre 4 (3,6/5) : malgré l’amère déception Parabellum, j’osais croire que cette année rectifierait le tir… ça a été À PEINE le cas. Avec ce pseudo-final, on est dans la continuité de la connerie régressive qui prend tout ce qui faisait le charme des deux premiers opus… sans y comprendre grand-chose, cf. l’intrigue portnawak dénuée d’inventivité (à l’exception du duel final), les dialogues truffés d’intenses moments de nullité, ou encore l’antagoniste sardonique tout droit sorti d’un mauvais dessin animé. Et surtout, Chad Stahelski a trouvé la technique pour faire durer un film trois heures : étirer en longueur pratiquement TOUTES les scènes. Quelques gros morceaux d’action et Donnie Yen (la classe incarnée) sauvent les meubles.
Au rayon « pourquoi tout le film n’est pas comme ça, déjà ? »
L’incroyablement singulier Désordres, de Cyril Schäublin, était programmé pour faire partie des « films que j’aurais aimé adorer »… mais justement, j’ai tellement ADORÉ sa dernière scène que je me sens obligé de lui réserver ce petit traitement de faveur.

Induit en erreur par le pitch, j’attendais du film qu’il me conte l’idylle, sur fond de mouvement social et de naissance de l’anarchisme suisse, entre l’intellectuel russe Kropotkine et la préposée aux balanciers Joséphine (incarnée par la singulièrement délicieuse Clara Gostynski). Or il faut attendre LA FIN DU FILM pour avoir droit au très, très beau moment ci-dessus, dont est tiré la photo qui a servi d’affiche. Parce que TOUT ce qui précède, ou presque, est comme… une fresque historique de 3h dont le cinéaste aurait sucré au montage TOUTES les scènes intimistes, dramatiques, consacrées à des personnages, relevant de l’intrigue, avec de la tension dramatique, des rebondissements, et tout… pour ne garder QUE les scènes d’atmosphères collectives, pleines de plans larges et souvent fixes – si ça, ça n’en dit pas long ! Pour raconter la façon dont le capitalisme s’empare de la technologie naissante afin d’en faire une arme contre le salarié, ou la façon dont les consciences des salariés de la petite ville sont remuées par les idéaux révolutionnaires, pourquoi pas ? C’est intéressant, comme expérience. Souvent pertinent. Et puis, c’est magnifiquement filmé sur pellicule, top 10 des plus mémorables emballages de l’année, facile. En plus d’être assez reposant. Mais… quid de l’histoire, gars ? Pourquoi attendre la TOUTE FIN pour nous proposer ça, ce monument de délicatesse romantique saisi à la volée, si tu en étais capable ? Où est le reste ? Parce qu’avec cette scène, où il ne se passe pratiquement RIEN, tout juste la tentative délicieusement laborieuse de Joséphine d’expliquer son travail à Kropotkine, on a pourtant un de mes moments de cinéma préférés de 2023. Pas besoin d’intensité dramatique, pas besoin de prise de tête narrative, la prise de tête de Joséphine suffit pour « faire » ce moment d’une grâce infinie.
Au rayon « chouchous de la critique que je conchie avec zèle »
– Le Garçon et le Héron (4,2/5) : coup dur. Bienvenue en 2023, dans un monde où le studio Ghibli peut être synonyme de médiocrité, et où la presse fanatisée peut aller se faire foutre. Une fois passé le prologue plutôt bien foutu, le film ne décolle jamais, et ce qu’on a à la place d’une lumineuse évasion miyazakienne est un lamentable spectacle d’autoparodie involontaire, aux frontières de la sénilité, qui ne suscite ni le rire, ni l’émotion, mal écrit de bout en bout, esthétiquement terne, même, et échouant constamment à être le nouveau Chihiro, avec son héron davantage hideux qu’intriguant, ses perruches soldates supposément collector, et son blabla nippon à deux balles sur le sens de la vie en phase avec son titre original pontifiant. Même Goro aurait fait mieux.
– The Killer (3,9/5) : ah, c’est très bien fichu, hein. Le brio de l’artisanat… la tension du montage… la minutieuse composition des plans… la sophistication des hommages… c’est du Fincher ! Et… est-ce qu’on en a quelque chose à foutre ? Euh, non. Du tout. Personnages vides, dramaturgie inexistante, platitudes d’une voix-off qui se croit « edgy » : bienvenue dans un cinéma impuissant, qui ne captive qu’à l’occasion d’UNE scène de baston. Je trouve un peu déprimant que le cinéaste cire si activement les pompes de Netflix alors qu’à ce jour, c’est pour EUX qu’il a pondu ses deux plus mauvais films, Mank, film autiste sur son rapport au cinéma, et celui-ci, film autiste sur son rapport au perfectionnisme. Il n’y a qu’UN The Killer.
– Barbie (3,5/5) : bien qu’une moyenne de 3,5 soit trop peu pour parler de consensus critique, FORCE est de reconnaître que ce machin a bénéficié d’une GRANDE complaisance dans la presse. Moi, il m’a diverti à… 20%, et donné envie de crever à 80. MÊME si j’adhérais à son féminisme, dont le manichéisme oppose dangereusement les deux sexes, j’aurais tout de même du mal, entre autres parce que le propos est rabâché ad nauseam (cf. la fin interminable), la partie mère/fille est écrite avec des moufles (affreuse America Ferrera), l’humour finit au second plan parce que Gerwig s’est bien trop prise au sérieux, et la plupart des numéros musicaux sont pourris, parce que c’est techniquement au point… mais de mauvais goût.

Le flop 10
J’ai beau n’avoir aucun problème de principe avec les suites au cinéma, une tendance s’est naturellement dessinée lors de la conception de cette liste. Numéro trois… numéro six… numéro dix… et ainsi de suite, tous désastreux, ou presque. Un résultat SI frappant que j’aurais justement aimé que ladite liste soit à 100% composée de suites, et non 80%, comme c’est le cas. Enfin, au moins, on n’aura pas l’impression que je m’acharne.
– Ant-Man 3 (Ant-Man et la guêpe) : c’est donc LUI, le grand méchant à venir du MCU ? Vraiment ? Madoué. Quoi ? Finalement, ça ne l’est pas, Disney a viré le gars ? Madoué. En fait, c’est comme si le film n’était jamais arrivé, du coup, non ? Si ? Je propose qu’on l’oublie, alors. Voilà, pouf.
– Scream 6 : ce machin est la PIRE suite qu’Hollywood a engendrée dans toute sa médiocrité depuis Jurassic World: Dominion. C’est tellement merdique que ça fait passer le 5ème volet (pardon, « Scream ») pour quelque chose de regardable et le 3ème pour un classique. C’est dire.
– Fast & Furious 10 : dans la foulée de l’abrutissant 9ème opus, une catastrophe dont la longueur grotesque ne fait qu’accentuer la dimension cancérigène. La médiocrité, sans filtre. Après le frère caché, le passé qui rattrape ? Gal Gadot revenant à la fin à bord d’un sous-marin ? Ou pas ?
– The Meg 2 (En eaux très troubles) : le blockbuster estival dans sa connerie la plus chimiquement pure, où RIEN n’a de poids et TOUT n’est qu’artifice… avec une cover chinoise des Ting Tings. Au passage, s’il y a un troisième Meg, ce sera quoi, le titre français ? En eaux TRÈS, TRÈS troubles ?
– Indiana Jones 5 (Indiana Jones et le Cadran de la destinée) (voir ci-dessous) : une DEUXIÈME suite de trop, produite par l’authentique progéniture de Satan qu’est Kathleen Kennedy, destructrice de mondes fictifs, et dont l’insupportable girl boss jouée par Waller-Bridge n’est que l’ultime clou.

– Equalizer 3 : j’entends l’argument : rarissimes sont les sagas filmiques dont la qualité ne décline pas avec le temps. Problème : il n’y a pas VRAIMENT eu de déclin, avec les Equalizer d’Antoine Fuqua, puisqu’ils sont TOUS nuls, le charisme d’un Denzel en pilote auto servant de cache-sexe à leur nullité…
– Captain Marvel 2 (The Marvels) : on a donc une des superhéroïnes les moins appréciées du public, rejointe dans son combat contre des méchants archi-génériques par une minette dont personne n’a vu la série et une autre nana aussi secondaire dont la nature des pouvoirs est archi-vague… et on s’étonne du four ?
– Rebel Moon : Partie 1 : une boursouflure plaqué or propre à embarrasser les défenseurs les plus tenaces de Snyder, AUTRE exemple de réalisateur iconique potentiellement ruiné par Netflix. Parce que c’est d’une médiocrité historique, là. À faire passer Jupiter Ascending pour du grand space opera. De l’ère pré-streaming.
– Napoléon : papy Ridley, pour son film sur Napoléon, nous pond… une bérézina cinématographique. Montage foireux avec des ellipses suicidaires, interprète sous Lexomil, féminisme à deux francs anciens, révisionnisme éhonté de connard qui n’assume même pas… une version longue ne sauvera pas cette horreur, pourrie DE NATURE.
– Vaincre ou mourir : il faut choisir. Et j’ai choisi… de ne pas laisser ma sensibilité conservatrice influer sur mon jugement. Car quand des gens échouent À CE POINT à comprendre comment on raconte une histoire à l’écran (cette voix-off, mon dieu !), il faut être intraitable.
Conclusion
Voilà l’ami, c’était mon top ciné de l’année 2023… un peu long, j’en conviens, mais que veux-tu, tel est le prix de la passion. Ou pas, va savoir. En espérant avoir convaincu au moins un ou deux clampins de découvrir les films du top qu’ils n’ont pas encore vus ! Ou des mentions !




