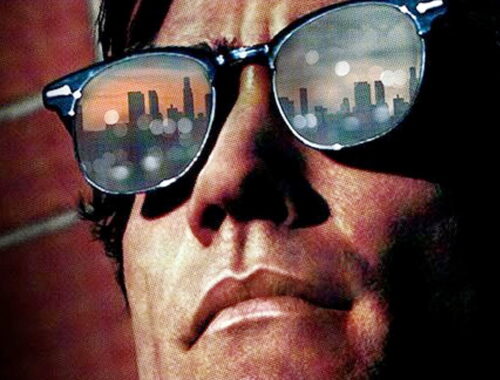Ma vie avec John F. Donovan
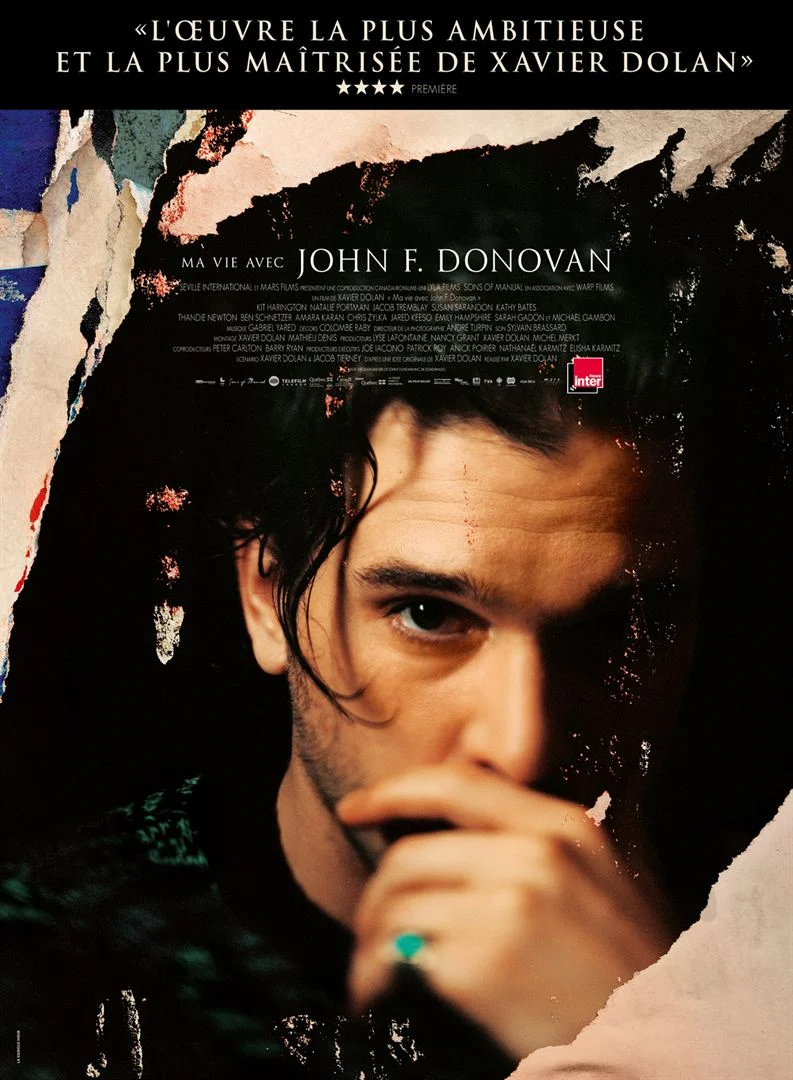 Il y a pire qu’un film narcissique : un film narcissique qui n’a rien d’intéressant à dire. Ma vie avec John F. Donovan, dont le titre français est complètement à côté de la plaque en ce que PERSONNE ne partage la vie du personnage-titre, et SURTOUT PAS le jeune protagoniste, est un film d’un narcissisme chimiquement pur, d’autant plus sidérant qu’il semble s’ignorer royalement, et qui, surtout, n’a rien à dire d’intéressant. Oui, nous parlons bien ici de narcissisme, la mégalomanie est autre chose. Qu’un grand metteur en scène soit mégalomane n’a rien de problématique. Par exemple, il faut l’être un peu, pour a) avoir envie de faire, b) imaginer qu’on PEUT faire, et c) FAIRE pour de bon Star Wars. Mais Star Wars, ce n’est pas deux heures de George Lucas se filmant le nombril en salivant. Or, JFD, c’est le petit chéri de ces dames (et de ces messieurs) Xavier Dolan filmant le sien de sa main droite, avec, dans la gauche, son braquemard fièrement tendu vers sa bouche – fantasme qu’il avoue à demi-mots dans son film via une réplique même pas cryptée d’Emily Hampshire (l’effet spécial de la série 12 Monkeys, au passage !). Il y a une différence entre traiter ses obsessions à travers son œuvre et se placer au CENTRE de ce traitement. Un spectacle d’autant plus difficile à supporter que Dolan s’apitoie sur son sort à travers ses personnages, par-dessus le marché. Parce qu’un sale con talentueux vaudra toujours mieux qu’un sale con sans talent. On se calme : nulle question d’affirmer que M. Dolan est sans talent (un sale con, ça, en revanche, je ne sais pas). Je ne suis pas un expert de son cinéma. Avant JFD, j’avais vu des morceaux des Amours Imaginaires, dont les jérémiades de l’acteur-réalisateur et la pose « Nouvelle Vague pour les nuls » m’avaient amplement suffi, et surtout Juste la fin du monde, qui ne m’avait pas vraiment convaincu, notamment à cause de sa propension à l’hystérie collective et son recours perpétuel à la pop music, sans pour autant me PASSER l’envie de regarder un autre film de ce jeune homme que sanctifie la presse depuis tant d’années. Après tout, si je m’étais tenu à distance de son cinéma, c’est seulement parce que ses sujets ne m’intéressaient pas. Alors, celui de JFD était-il plus séduisant ? Pourquoi pas. En tout cas, capable d’attiser la curiosité de tout cinéphile ayant un penchant pour les œuvres dites « malades ». Car tout portait à croire qu’il s’agirait d’un film sacrément malade, à commencer par les deux années de montage (!!) et le sucrage intégral de Jessica Chastain en postproduction (!!!). La question rendait curieux : comment le petit gars s’en était-il sorti ?
Il y a pire qu’un film narcissique : un film narcissique qui n’a rien d’intéressant à dire. Ma vie avec John F. Donovan, dont le titre français est complètement à côté de la plaque en ce que PERSONNE ne partage la vie du personnage-titre, et SURTOUT PAS le jeune protagoniste, est un film d’un narcissisme chimiquement pur, d’autant plus sidérant qu’il semble s’ignorer royalement, et qui, surtout, n’a rien à dire d’intéressant. Oui, nous parlons bien ici de narcissisme, la mégalomanie est autre chose. Qu’un grand metteur en scène soit mégalomane n’a rien de problématique. Par exemple, il faut l’être un peu, pour a) avoir envie de faire, b) imaginer qu’on PEUT faire, et c) FAIRE pour de bon Star Wars. Mais Star Wars, ce n’est pas deux heures de George Lucas se filmant le nombril en salivant. Or, JFD, c’est le petit chéri de ces dames (et de ces messieurs) Xavier Dolan filmant le sien de sa main droite, avec, dans la gauche, son braquemard fièrement tendu vers sa bouche – fantasme qu’il avoue à demi-mots dans son film via une réplique même pas cryptée d’Emily Hampshire (l’effet spécial de la série 12 Monkeys, au passage !). Il y a une différence entre traiter ses obsessions à travers son œuvre et se placer au CENTRE de ce traitement. Un spectacle d’autant plus difficile à supporter que Dolan s’apitoie sur son sort à travers ses personnages, par-dessus le marché. Parce qu’un sale con talentueux vaudra toujours mieux qu’un sale con sans talent. On se calme : nulle question d’affirmer que M. Dolan est sans talent (un sale con, ça, en revanche, je ne sais pas). Je ne suis pas un expert de son cinéma. Avant JFD, j’avais vu des morceaux des Amours Imaginaires, dont les jérémiades de l’acteur-réalisateur et la pose « Nouvelle Vague pour les nuls » m’avaient amplement suffi, et surtout Juste la fin du monde, qui ne m’avait pas vraiment convaincu, notamment à cause de sa propension à l’hystérie collective et son recours perpétuel à la pop music, sans pour autant me PASSER l’envie de regarder un autre film de ce jeune homme que sanctifie la presse depuis tant d’années. Après tout, si je m’étais tenu à distance de son cinéma, c’est seulement parce que ses sujets ne m’intéressaient pas. Alors, celui de JFD était-il plus séduisant ? Pourquoi pas. En tout cas, capable d’attiser la curiosité de tout cinéphile ayant un penchant pour les œuvres dites « malades ». Car tout portait à croire qu’il s’agirait d’un film sacrément malade, à commencer par les deux années de montage (!!) et le sucrage intégral de Jessica Chastain en postproduction (!!!). La question rendait curieux : comment le petit gars s’en était-il sorti ?

Un plan lose dès le départ ?
De prime abord, on a envie de dire qu’il ne s’en est PAS sorti, du tout, parce que ça saute aux yeux, que le film a peiné à venir au monde. Deux ans sur le banc de montage, ce n’est jamais un bon signe. Un coup d’œil à 2046 suffisait à comprendre que Wong Kar-Wai s’était complètement paumé en route. Pour que ça fonctionne, il fallait à la fois du génie et un sacré alignement des astres : citons l’Apocalypse Now de Coppola. Or Xavier Dolan n’est ni Lucas, ni Wong, ni Coppola. Le gars se paie, ou plutôt la production LUI paie, les services d’une star hollywoodienne, qui plus est rousse (!!!!!!!), pour interpréter un rôle sans nul doute considérable, et APRÈS avoir entièrement tourné le machin, il décide que tout ce qui la concerne ne fonctionne pas, et flip-flap la rouquine ? Et l’on s’attend à ce que ça tienne la route ? Terrence Malick a fait ça sur La Ligne Rouge, mais rebelote, Dolan n’est PAS Malick : JFD n’est PAS un film choral sur un sujet universel. En le regardant, on sent qu’il y a eu du boulot, mais du boulot sur l’arrière-plan, pas sur l’intrigue, elle, totalement décousue. On sent que la grande Kathy Bates a tourné plus de scènes, des scènes qui donnaient un sens à son personnage d’agente, et que Dolan l’a enterré en lui laissant à peine deux maigres moments qui, en l’absence du reste, ne produisent aucun effet et manquent de cohérence (les reproches moraux qu’elle fait à John, en plus d’être exagérés, ne cadrent pas avec son attitude de connasse impitoyable à la toute fin de la scène). On constate que John (Kit Harrington) a des problèmes d’ouïe, mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe, et l’on imagine bien que Dolan a filmé des scènes introduisant ce handicap. On voit que la mère de John (Susan Sarandon) est une épave… puis quelques scènes plus tard, pas tant que ça… et John semble la détester… puis quelques scènes plus tard, peut-être pas à ce point-là… sans que ça ne tienne jamais vraiment la route. On sent très vite les sérieux problèmes d’articulation entre la partie Harrington, la partie Tremblay/Portman, et la partie Newton/Schnetzer (j’ai eu besoin d’IMDb pour connaître son nom, que je pense oublier d’ici cinq minutes), et c’est triste à dire, mais l’on N’OSE imaginer à quel point le film aurait été imbitable si Dolan avait conservé la partie Chastain au montage. On a posé le doigt sur le problème central de l’histoire : JFD traite d’une relation épistolaire dont on ne profitera jamais, qui ne prendra jamais forme, laissant John et Rupert dans leurs mondes respectifs, hermétiques. « Ma vie », qu’il disait !

Mais réflexion faite, cela n’a rien à voir avec des petits tracas d’organisation d’un génie bordélique et TOUT avec le fait que l’idée de départ de JFD est juste pourrie. Même si le film avait été plus court pour satisfaire davantage les spectateurs pas super friands d’interminables enfantillages, même s’il avait été moins décousu (mieux cousu ?), il n’aurait pas pour autant fonctionné. Parce qu’on peine à voir la plus-value de cette histoire tarabiscotée de relation épistolaire entre un petit con de onze ans, que son homosexualité précoce est censée rendre magiquement intéressant (la fameuse « différence »), et qui cause comme un critique littéraire à col roulé de cinquante berge (me rappelant mon mioche mal écrit préféré, celui du Cercle, de Gore Verbinski !), et un bellâtre de séries télé, lui aussi gay (comme le monde est bien fait !), et dont les deux seules caractéristiques sont a) d’être encore dans le placard, parce que le show-business des années 2000 est CLAIREMENT aussi invivable pour la communauté LGBT que l’Amérique des années 50, et b) d’exprimer ce malaise avec l’éloquence d’un autiste. Peut-être lui trouvera un intérêt un jeune public masculin, aspirant-acteur, « queer », et écrivant régulièrement à des stars hollywoodiennes comme c’était le cas de Dolan… mais ça en dirait long sur l’ouverture d’esprit et la portée du film.
Médiocre Narcisse
Et c’est la raison pour laquelle on en est certain, au bout de deux heures : OUI, il faut un SACRÉ paquet de narcissisme pour penser qu’on va captiver son monde avec un truc pareil. Captiver de parfaits étrangers avec soi, en fait. Non, l’acte de création n’est pas étranger au « Moi, je »… mais Dolan a fait une overdose. Le gars, qui a confié ses deux principaux rôles masculins à deux acteurs lui ressemblant (Harrinton et Schnetzer), s’est placé au centre du monde. Le personnage de Rupert adulte, autrement dit LUI, passe une demi-heure en compagnie d’une journaliste quadragénaire, chevronnée, qui a parcouru le monde (Thandie Newton), et il parvient à lui retourner le cerveau avec une histoire d’acteur suicidaire et de fanboy vaguement brimé au collège. Le personnage de John, autrement dit LUI aussi, se pose au fond d’un diner miteux pour gribouiller, puis pouf, Michael Gambon, Dumbledore en personne, arrive pour lui donner des conseils de vie (d’une platitude douloureuse, au passage), juste parce que John le mérite, vous comprenez. Rupert garçon, même topo, n’est-il pas considéré par sa professeure comme un être « exceptionnel » ? C’est la fête du slip, pour les petits Xavier de tous les âges.

Mais seul dans son coin, alors. JFD donne l’impression que le professeur préféré de l’appliqué petit Dolan lui a donné comme devoir de conjuguer du mieux qu’il pouvait médiocrité et prétention. Étant donné qu’il est supposé filmer la médiocrité du showbiz, d’aucuns argueront que la médiocrité de son emballage est intentionnelle, simulée, un peu comme c’était le cas du Bling Ring de Sofia Coppola… mais il n’en est rien. Sa médiocrité, c’est de la bonne, de l’authentique. Pas un moment de son film, ou presque, n’est épargné par ce mélange improbable, l’« auteur » nous imposant un spectacle affligeant de caricature et d’artificialité en croyant filmer un grand récit existentiel, ambition exprimée dès son titre original au pompiérisme puéril : « The Death and Life »… hé, les gars, vous avez vu cette déconstruction métaphysique, cette mise en abyme spatiotemporelle ? Non, vous l’avez pas vue ?
Oui, parce qu’on s’en fout un peu, en fait
On dit qu’il n’y a pas de mauvais sujets, que des mauvais développements : preuve que si. Dolan fait dire à Rupert adulte, lors d’une des ridicules scènes d’interview, qu’une histoire n’a pas à se situer dans le Liberia en guerre pour mériter d’être contée. Et c’est VRAI, soyons clair. La logique du « rich people’s problem » (très souvent agrémentée du substantif « white ») est aberrante, en plus d’être la manifestation d’un ressentiment méprisable : dans ce cas, la littérature de F. Scott Fitzgerald ou celle de Dostoïevski n’auraient pas le droit de toucher ? Sur le moment, on soutient d’autant plus Rupert qu’il envoie cette remarque à la figure de la journaliste, personnage que Dolan a rendue bien opportunément insupportable en deux-trois répliques du genre de « oh, un autre petit Blanc qui s’est fait brimer, bouhou » (‘dafuq ?), et que Thandie Newton n’a pas exactement repêché avec sa performance calamiteuse, du niveau d’une doubleuse de méchante de série animée pour écoliers. HÉLAS, dans ce cas précis, le pauvre Rupert a à la fois raison… et tort, puisqu’on aurait CLAIREMENT préféré s’aventurer dans le Liberia en guerre.

Exploit potentiel : on trouvera sans aucun doute plus d’humour, même, dans le Liberia en guerre, que dans ce film au sérieux dramatique. C’est souvent un signe, l’absence d’humour. Dolan ne se contente pas de se regarder filmer, on vous l’a dit : il chouine. Il en fait des tonnes. Son film est un mélodrame permanent, par ailleurs pour des raisons qui nous échappent. Mettre en scène une interview (à laquelle la partie jouée par Jessica Chastain ne pouvait QU’ÊTRE supérieure…), c’est sa façon à lui de s’exhiber en dissertant, de disserter en s’exhibant. Et ça fatigue. En dehors d’un John un tant soit peu touchant mais en aucun point captivant, AUCUN personnage ne semble authentique. On se fout du gamin. Le jeune Jacob Tremblay est assurément talentueux, on avait pu le constater dans Room, mais aucun acteur ne pouvait rendre fréquentable un petit con pareil, que l’hystérie dolanienne flingue très tôt avec cette scène où il braille non-stop devant la télévision, ni même intriguant, comme nous l’avons vu plus haut. On se fout de la mère du gamin : les motivations du personnage, les raisons de son attitude défaitiste, tout baigne dans un flou artistico-psychologisant qui tue TOUTE chance de s’attacher à elle, ou de lui pardonner son attitude de connasse face à la gentille prof (cliché inside !). On se fout de la version ADULTE du gamin, expert en bavardage prétentieux. On se fout de la mère de Donovan, cliché de génitrice ratée, puérile et alcoolique, élément central d’une scène de déballage familial névrotique qui soûlait déjà dans Juste la Fin du Monde, et thérapie ambulante. On se fout également de sa pseudo-compagne, Amy Bosworth, version sous-traitée du personnage de Mary Austin dans le pourtant mauvais Bohemian Rhapsody (étrange hasard, Emily Hampshire a des airs de Lucy Boynton…). Un critique a parlé de personnages « servant de marionnettes ventriloques à Dolan pour pousser des coups de gueule grossiers » ; c’est exactement ça, et à en croire les connaisseurs du cinéma de Dolan, le minet semble être un spécialiste en la matière : la fabrication artificielle de conflit, au détriment des personnages, qui basculent sur commande dans une hystérie grotesque, pour ajouter de la tension, par un cinéaste qui semble être une sacrée « drama queen » officielle du septième art. Voir cet énième moment de ridicule où un gros boulet de l’équipe de tournage vient littéralement BRIMER le héros après son outing, alors que ce dernier est clairement sur le point de craquer. Que le protagoniste stresse à l’idée que son secret soit révélé au grand jour ne suffisait pas, non, il fallait un beauf pour mettre de l’animation.
De cette chienlit, aucune actrice ne ressort grandie : Natalie Portman, qui n’a aucune alchimie avec Jacob Tremblay, est un miscast absolu (à l’époque, je m’étais dit « heureusement qu’il y a eu Jackie, depuis Black Swan, car sans cela, on serait en droit de se demander si fifille n’est pas sur le déclin… ») ; Susan Sarandon en fait des TONNES là où Nathalie Baye sauvait au moins un peu les meubles dans le précédent Dolan, sans doute pas vraiment aidée par la boucherie du montage comme nous l’avons vu plus haut ; et le cas Thandie Newton a déjà été abordé, le fossé entre Westworld et ce film montrant non seulement la limite de son talent d’actrice, mais aussi l’importance de la direction d’acteurs.

Romantisme de beauf
Autant dire, donc, que pour le souffle romanesque ardemment convoité, vous devrez repasser. C’est presque une blague : rien, dans JFD, n’a la moindre gueule. Et la conjugaison du nombrilisme du cinéaste avec son penchant pour le pathos conduit à un festival de beaufitude lorsque s’y ajoutent ses fameux choix musicaux. Dans Juste la Fin du Monde, ça ressemblait à Nathalie Baye et Léa Seydoux dansant n’importe comment sur Dragosta Din Tei d’O-Zone. Ici, le choix ne manque pas, mais ressortent quand même du lot deux moments « inoubliables » : d’abord, le petit Rupert courant dans les bras de sa môman à la fois SOUS la pluie et SUR une cover ignoble de Stand By Me (à ce stade, on n’est tellement pas impliqué émotionnellement que chaque seconde donne des bleus à l’âme) ; ensuite, ce moment encore plus ridicule où Donovan chante (mal) Hanging By a Moment dans son bain, en compagnie de son grand-frère, qui n’est pas dans la baignoire mais quand même très près, et sous le regard affectueux de leur mère, parce qu’elle aussi se balade dans la salle de bain, peinarde, lorsque ses fils s’y frottent le zigouigoui – un élément de la culture locale, peut-être. JFD n’est même pas beau à voir : l’obsession dolanienne pour les gros plans, ici en quantité indécente (on se demande à quoi ça servait, de filmer à Los Angeles puis Prague, étant donné qu’on n’en voit rien) et souvent mal fichus (un rapport avec le fait que c’est le premier film du gars en cinémascope ?), et son abus des regards caméra, accentuent la surcharge de pathos.
Les fans de Dolan voient dans ces scènes de grands moments de « spontanéité », une « fraîcheur désarmante ». « Il est comme ça, Xavier, il a pas honte d’avoir aimé de la merde quand il était gamin, et toc, ÇA, c’est du cinéma sans concession. » Mm-mmh. Au rayon « porte grande ouverte aux pires merdes sous prétexte que quelqu’un, quelque part, l’a vécu dans la vraie vie », ça se pose quand même bien là, leur truc. À ce qu’il paraîtrait, tous les goûts se valent. Non seulement on demande à voir, mais surtout, il existe une chose telle que le caractère, et les choix musicaux du cinéma de Dolan semblent n’en avoir aucun. Le spectateur n’en a, a priori, rien à carrer, que telle chanson l’ait excité à la radio lorsqu’il était collégien. Adolescent dans les années 90, j’ai eu une phase eurodance ; ça a beau être super authentique, il ne me viendrait jamais à l’esprit d’infliger ça à quiconque si jamais je faisais un film. Sauf peut-être à Raphaël Glucksmann.

Franchement, comment sauver d’un ridicule fatal un film qui se choisit, pour dernier plan, celui de Thandie Newton, souriant comme une demeurée à la leçon de vie supposément formidable que l’adulte super-épanoui Rupert vient de lui transmettre ? Un sourire gaga pour un plan qu’on croirait tout droit sorti d’une pub Nespresso, au bout de deux heures d’un ego-trip aux frontières de l’indécence ? Comment, avec la tête dans le guidon pendant deux abrutissantes années de postproduction, Dolan pouvait-il monter son film AUTREMENT que n’importe comment, achevant ainsi un projet… non pas mort-né, mais né en très mauvaise santé ? En fait, comment ce foutu bazar a-t-il pu être « green-lighté » ?! Ah oui, c’est vrai : on ne discute pas avec un « auteur »…
« Plus jamais ça », version film d’auteur oedipien
L’affaire est donc pliée, les amis : on a beau dire « jamais deux sans trois », je ne donnerai pas une troisième chance à la jeune idole des vieux (une sorte de Macron du cinéma ?), à présent certain que Gaspard Ulliel est l’essentiel de ce qui rendait Juste la Fin du Monde appréciable – et autant dire que Kit Harington n’est PAS Gaspard Ulliel. Une unanimité critique ne me fera certainement pas changer d’avis parce que l’unanimité est, par nature, douteuse. « Complexification du fond et épure de la forme » pour Les Inrocks ? « Amour enragé du septième art » pour Première ? « Sublime film-somme » pour CinemaTeaser (ok, pas le titre le plus prestigieux, mais je n’ai juste pas envie de citer Marie Claire) ? Juste non.
À plusieurs reprises, Rupert adulte dit à son intervieweuse qu’ils vivent dans le « même monde », des backrooms de L.A. aux terres sauvages des freedom fighters. Le cinéaste semble tenir à ce concept. Le nombril d’une fashion-victime prépubescente, les backrooms de L.A., les terres sauvages des freedom fighters, « même monde », « we are the world », toussa. C’est bô. Mais… dans ce cas, pourquoi Ma vie avec John F. Donovan donne-t-il l’impression INVERSE ?
Al, le critique de métal plein
Notes
– Ci-dessous, quelques photos de tournage supplémentaires, dont la dernière donne une idée de ce qu’y aurait donné Jessica Chastain… ouep.